Dans le portrait que je souhaite vous brosser ici, je
reprends, comme dans mon épisode sur Mike Osborne, un sujet que j’avais déjà traité
dans les premières années de mon blogue; cette fois-ci mon attention se portera
sur un autre saxophoniste alto, Marion Brown, à qui j’avais consacré un court
article en 2009. J’avais intitulé cet article Marion Brown, ni vu ni connu,
tentant de souligner le relatif oubli critique dans lequel Brown se trouvait
alors; après de longues années de maladie, le saxophoniste allait s’éteindre l’année
suivante. Depuis cette époque (et même un peu avant), des efforts ont été faits,
autant du côté de la critique que de certains musiciens actuels, pour revaloriser
l’œuvre de ce pionnier du free jazz, qui reste malgré tout relativement méconnu
si on le compare avec certains de ses contemporains comme Cecil Taylor ou
Ornette Coleman. Avec de nombreuses rééditions (notamment de ses albums Impulse
des années 1970, longtemps hors des catalogues), quelques parutions de bandes
inédites et deux ou trois hommages, sa position au panthéon du jazz semble un
peu plus solide que lorsque j’ai écrit mon article il y a une douzaine d’années;
cependant, sa longue absence de la scène à partir des années 1990 l’ont privé d’une
situation de proéminence à laquelle il aurait eu droit, et si on se souvient de
lui aujourd’hui, c’est peut-être surtout pour son travail des années 1960, la
grande époque de la New Thing.
Pourtant, si on étudie un peu le parcours de Marion Brown,
on se rendra rapidement compte qu’on ne peut pas le réduire à un freejazzman de
la première génération : sa proximité avec la scène européenne dès la fin
des années 1960, ses collaborations avec une nouvelle génération de musiciens
créatifs afro-américains, et ses études d’ethnomusicologie montrent notamment
sa grande ouverture et sa volonté de ne pas s’enfermer dans le carcan du free jazz
(par ailleurs largement créé par certains critiques). Au début des années 1970,
avec une trilogie d’albums inspirés par sa Géorgie natale, Marion Brown réalise
sans doute son travail le plus original. Par la suite, cet amoureux du blues
reviendra à des formes plus conventionnelles, mais sa sonorité fragile, lyrique,
vocalisée, très humaine (partiellement inspirée, comme chez Anthony Braxton, de
Paul Desmond), continuera de le placer à mille lieues des saxophonistes plus «formattés»
qui sortent des écoles de jazz dès le début des années 1980. Dans son cas on
peut certainement dire que son style reflétait bien le personnage qu’il était
en public : sérieux, presque taciturne, intellectuel, engagé (notamment
dans les luttes pour les droits civiques), mais aussi sensible et conscient de
l’importance de certaines traditions.
Né à Atlanta en 1931 (et non pas en 1935 comme mentionné
dans plusieurs références), Brown est donc un presque contemporain d’Ornette
Coleman. Élevé par une mère monoparentale, il s’enrôle très tôt dans l’armée;
déjà marqué par la musique de Charlie Parker, il avait débuté le saxophone alto
dans son adolescence, puis allait étudier l’instrument au Clark College à Atlanta,
avec un ancien de chez Benny Carter et Chick Webb, le saxophoniste et flûtiste
Wayman Carver. On le retrouve ensuite à Washington D.C., étudiant en droit à la
Howard University; quand il se rend finalement à New York en 1962, il est déjà
familier avec la musique de l’avant-garde jazzistique naissante, celle de
Coleman et Coltrane. Membre de la Jazz Composers Guild, proche un temps de Bill
Dixon et de Sun Ra (on peut l’entendre jouer quelques pièces du maître de l’Arkestra
sur un CD des années 1990, en duo avec Gunter Hampel), c’est surtout par son
association avec Archie Shepp qu’il sera d’abord remarqué. On l’entend sur Fire
Music, le second album de Shepp pour Impulse, et les deux saxophonistes
font évidemment partie de l’impressionnante cohorte réunie par John Coltrane
pour une session révolutionnaire en juin 1965 (avec John Tchicai, Pharoah
Sanders, Freddie Hubbard, etc.) pour ce qui deviendra Ascension, document
fondateur de la deuxième vague du free jazz qui déferle bientôt sur New York. Si
on ne peut pas l’accuser d’avoir «surfé» sur cette vague, Marion Brown en est
bien une des figures centrales dans ces années 1965-66, avec deux albums sur le
label underground ESP-Disk’ (Marion Brown Quartet et Why Not,
dont nous avons entendu un extrait en ouverture), une participation au quartette
du pianiste Burton Greene (qui le considérait déjà comme un ancien), puis son
propre album sur Impulse, Three for Shepp, un clin d’œil à Archie bien
sûr, mais aussi au premier album Impulse de ce dernier, Four for Trane,
placé sous le parrainage de John Coltrane. Je vous propose de visionner un petit documentaire de Henry English où on entend le quartette de
Marion Brown en 1967, avec Dave Burrell, Bobby Kapp et son compatriote d’Atlanta,
le contrebassiste Norris Jones, dit Sirone :
Mais déjà à cette époque, Marion Brown va se tourner vers l’Europe :
son album Juba-Lee, enregistré en novembre 1966 à New York, ne paraît qu’en
Europe (et au Japon) sur étiquette Fontana. En 1967, il se fixe à Paris, où il
est artiste en résidence à la Cité internationale des Arts; s’il s’associe
alors naturellement à certains musiciens français ayant adopté les nouvelles
formes du jazz du moment (par exemple Beb Guérin ou Jacques Thollot), c’est
aussi à cette époque qu’il va initier une longue collaboration avec le
multi-instrumentiste allemand Gunter Hampel, en plus de faire appel à certains Américains
exilés en Europe, notamment Barre Phillips, Steve McCall, Kent Carter, Jeanne
Lee, mais aussi Leo Smith, jeune représentant d’une nouvelle sensibilité
illustrée à Chicago par l’AACM, avec qui Brown grave un album en duo en 1970. On
l’entend aussi en Belgique, aux Pays-Bas (l’album Porto Novo le fait
entendre en trio avec de jeunes représentants de l’Instant Composers Pool,
Maarten Altena et Han Bennink), dans différents festivals (le Free Jazz Meeting
de Baden-Baden, le festival de Molde en Norvège, l’International Holy Hill Jazz
Meeting de Heiligenberg); son association avec Hampel donne naissance à deux
albums sur l’étiquette Calig (Gesprächsfetzen et In Sommerhausen),
mais aussi à la trame sonore d’un film de Marcel Camus mettant en vedette Nino
Ferrer, Le Temps Fou, dont le disque est apparemment sorti avant le
film, qui n’apparait sur les écrans qu’en 1970 sous le titre Un été sauvage.
Extrêmement rare pendant des années, l’album est reparu l’an dernier en
réédition vinyle; en plus de Brown et Hampel, on peut y entendre le
trompettiste Ambrose Jackson, Barre Phillips, Steve McCall, et, aux percussions,
le cinéaste Alain Corneau!
Pour illustrer l’époque européenne de Marion Brown, je vous
propose de regarder un extrait des archives de l’INA filmé en 1967 avec Beb
Guérin à la contrebasse et Eddy Gaumont à la batterie; la pièce (qui apparait
également sur l’album Porto Novo) s’intitule Sound Structure :
Revenu aux USA en 1970, Marion Brown va souhaiter voir son fils naître à Atlanta malgré tout : revenu en Géorgie, il va célébrer les traditions du Sud et se remémorer les lieux de son enfance à travers une trilogie d’albums enregistrés entre 1970 et 1974. C’est d’abord Afternoon of a Georgia Faun, quatrième titre de l’étiquette de Manfred Eicher, ECM, qui se distingue déjà par une approche originale au jazz contemporain et par une prise de son spacieuse. Si le titre est un clin d’œil à Debussy, Brown crée une véritable symphonie minimaliste pour «petits instruments» sur la pièce-titre qui occupe la première face du disque : divers instruments de percussion, cloches, gongs, utilisation des ressources de la voix humaine (sifflements, claquements de langue, etc.), flûtes, occupent la première partie, alors qu’une contribution atonale surprenante de Chick Corea et la voix saisissante de Jeanne Lee dominent la deuxième partie de la pièce. Sur la deuxième face, occupée par Djinji’s Corner (Djinji est le prénom du fils de Brown, devenu depuis un artiste de hip-hop), les instrumentistes occupent des rôles un peu plus conventionnels au sein du développement de la pièce; mais la véritable originalité de l’album provient de la présence de trois «assistants», des non-musiciens que Brown a totalement intégrés à la performance. Les deux albums suivants de la trilogie se retrouvent chez Impulse, label avec lequel Brown renoue après son séjour européen. Si l’étiquette s’est quelque peu assagie après la disparition de John Coltrane en 1967, la présence au catalogue d’artistes comme Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Albert Ayler, Ornette Coleman, Dewey Redman, Sam Rivers, le retour de Brown et Archie Shepp et le passage de Sun Ra sont autant de liens du label avec l’avant-garde dans la première moitié des années 1970. Geechee Recollections et Sweet Earth Flying, enregistrés et parus en 1973 et 1974 respectivement, complètent cette trilogie en demi-teinte où l’esprit de l’auteur perce comme peut-être nulle part ailleurs dans son œuvre. Le premier album Impulse évoque les Geechees (ou Gullahs), une communauté du Sud-Est des USA (Géorgie bien sûr, mais aussi les Carolines et le Nord de la Floride) qui a développé par sa relative isolation une culture créolisée mais qui conserve des éléments culturels venus d’Afrique centrale et de l’Ouest, notamment dans leur patois. L’évocation de la culture Geechee est renforcée par la présence de plusieurs percussionnistes, dont Steve McCall, Jumma Santos et le ghanéen A. Kobena Adzenyah. La poésie de Jean Toomer surgit sur Karintha, Buttermilk Button est un thème boppisant et bluesy rappelant un peu l’Art Ensemble of Chicago, exposé par Brown et Leo Smith, et les trois mouvements de Tokalokaloka ramènent aux stratégies de Afternoon of a Georgia Faun. Le troisième album de la trilogie, Sweet Earth Flying, laisse une bonne place à deux claviéristes aux styles fortement individuels, Paul Bley et Muhal Richard Abrams, qui utilisent l’instrument acoustique mais aussi le piano électrique et l’orgue; pour sa part, Brown y est à son plus lyrique à l’alto comme au soprano. Divisé en deux suites, l’album utilise certains procédés qui ne sont pas sans rappeler les constructions électriques contemporaines de Miles Davis. Mais écoutons plutôt un extrait de Geechee Recollections, une évocation du quartier d’Atlanta baptisé Buttermilk Bottom :
Après les curieux Vista (qui mêle des pièces de Stevie
Wonder et de Harold Budd - il reprendra Bismillahi ‘Rrahmani ‘Rrahim sur
l’album de Budd The Pavilion of Dreams trois ans plus tard) et Awofofora
(qui l’intègre dans un contexte presque fusion, avec des relents latins ou
reggae), Marion Brown obtient une maîtrise en ethnomusicologie de l’université
Wesleyan en 1976. On le voit aussi sur la scène des lofts à New York : il
apparaît par exemple sur la série Wildflowers, enregistrée lors d’un
festival au Studio RivBea de Sam Rivers la même année. Si sa musique semble s’assagir
à la fin des années 1970 (un peu à l’image de son ancien comparse Archie
Shepp), Brown trouve aussi de nouveaux champs d’expression, réalisant des
albums en solo (Solo Saxophone, paru en 1977 sur son propre label, Sweet
Earth Records, puis Recollections : Ballads and Blues for Alto
Saxophone, paru en 1985 sur le label suisse Creative Works) ou en duo avec
son vieux camarade européen Gunter Hampel (Reeds ‘n’ Vibes, Gemini).
Avec ses groupes réguliers cependant (sections rythmiques distinguées dont font
partie par exemple Stanley Cowell, Kenny Barron, Hilton Ruiz, Dave Burrell,
Reggie Workman, Cecil McBee, Roy Haynes, Philly Joe Jones, Warren Smith ou
Freddie Waits), le saxophoniste va surtout traiter un répertoire bien établi, dont
les jalons sont Fortunato, La Placita, Sweet Earth Flying,
Sunshine Road et le très beau November Cotton Flower; ce sont ces
thèmes et quelques standards qui forment la base de ses albums des années 1978-1980
pour le hollandais Timeless (La Placita – Live in Willisau), les
japonais Baystate (November Cotton Flower) et DIW (79118 Live) ou
le français Free Lance (Back to Paris). Sur Passion Flower, de
1978, il rend hommage à une de ses influences premières, Johnny Hodges, avec
des reprises de classiques de Ellington et Strayhorn. En 1979, la pianiste
Amina Claudine Myers interprète tout un album de ses pièces pour piano :
baptisé Poems for Piano, le disque est paru sur Sweet Earth Records.
Dans les années 1980, en duo avec Mal Waldron, il réalise
deux superbes albums pour Free Lance, Songs of Love and Regret (enregistré
en 1985) et Much More! (enregistré en 1988); on l’entend aussi avec Ahmed
Abdullah, Billy Bang, Sirone, Fred Hopkins et Andrew Cyrille au sein de The
Group, incarnation tardive du Loft Jazz, dans les années 1986-87. Brown se
consacre aussi aux arts visuels et à la poésie, et publie en 1984 le livre Recollections,
sous-titré Essays, Drawings, Miscellanea. Mais Marion Brown ralentit
aussi beaucoup ses activités à partir de la fin des années 1980; on l’entend
avec le groupe allemand Jazz Cussion, et il grave deux disques pour la
japonaise Venus (Offering et Mirante do Vale : Offering II);
on l’entendra surtout par la suite comme invité sur certaines pièces de son
fils Djinji. Il est également interviewé dans le documentaire Inside Out in
the Open de Alan Roth. Mais depuis la fin des années 1990, des problèmes de
santé et plusieurs opérations le tiennent éloigné de la scène; il passera ses
dernières années en Floride, dans une résidence. Marion Brown s’est éteint en
octobre 2010, à l’âge de 79 ans. Parmi les hommages à ce musicien hors normes,
mentionnons la pièce Song for Marion Brown sur l’album de Superchunk Indoor
Living en 1997, le disque Sweet Earth Flower de His Name is Alive en
2007, et Le Temps Fou du pianiste guadeloupéen Jonathan Jurion, paru en
2019.
Je vous propose de terminer ce portrait sur cet extrait vidéo en duo
avec Mal Waldron, filmée à Rennes en 1988. Quant au Viking, il devrait revenir
la semaine prochaine pour un nouveau portrait. D’ici là, restez négatifs (au
Covid) et abonnez-vous à mes chaînes Twitch et YouTube et à ma page Facebook. À
la prochaine!
On consultera une excellent discographie de Marion Brown en ligne ici.
Soulignons aussi un très bon texte sur la trilogie Afternoon of a Georgia Faun / Geechee Recollections / Sweet Earth Flying par The Bitter Southerner.




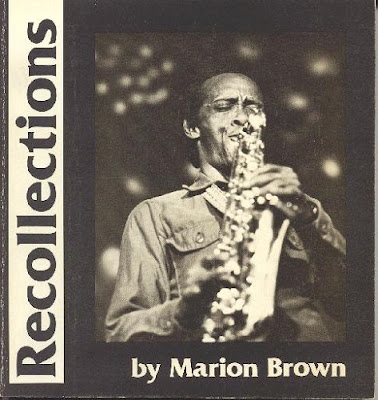













.jpg)






