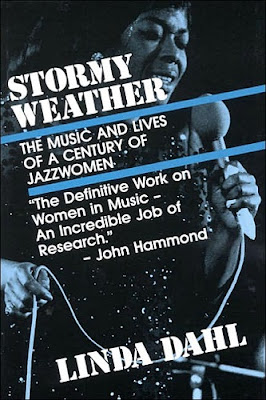Les International Sweethearts of Rhythm.
Cette année, pour le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, j'ai eu envie d'écrire pour toutes les hip chicks (et tous les jazz cats) ce texte que j'ai baptisé Femmes de jazz.
Quand on pense aux femmes de jazz, on
pense presque automatiquement aux chanteuses : Billie
Holiday et son gardénia, Ella Fitzgerald saisie
au vol en plein scat, ou encore Nina Simone et
sa colère nécessaire… et avec cause : qui mettrait en doute l’immense
talent de ces trois-là et de bien d’autres, de Ethel Waters et Bessie Smith aux
nombreuses interprètes de talent de notre époque. Mais ces images, qui nous
viennent spontanément, mettent les femmes de jazz un peu à côté (ou
souvent devant) les autres musiciens. Par sa situation, la chanteuse de
jazz a longtemps été une exception, une attraction à part au sein des
orchestres de jazz; aujourd’hui même, la publicité met souvent de l’avant
l’image très glamour de la chanteuse de jazz, quitte à laisser les
musiciens et musiciennes bien loin derrière dans le décor. On peut penser par exemple à ces photos de celles qu’on appelait «canaris» à
l’époque des big bands : d’un côté une douzaine d’hommes, en tuxedos noirs
avec leurs instruments, et de l’autre la chanteuse, en robe blanche, qui vient
faire son numéro… Bien sûr l’image est marquante, mais en réalité nombre de
chanteuses cherchaient souvent à n’être qu’un autre des «gars du band», depuis
Billie Holiday jusqu’aux vocalistes free des années 1970. Quoiqu’il en soit, l’univers
des chanteuses de jazz est vaste et mériterait à lui seul plusieurs diffusions;
aujourd’hui j’ai plutôt cherché à faire un panorama de celles que l’histoire a
souvent occultées, méprisées et sous-représentées : les instrumentistes féminines dans le jazz. Pour ce
faire, j’utilise entre autres le livre de Linda Dahl paru en 1984, Stormy
Weather : The Music and Lives of a Century of Jazzwomen; c’est de ce
livre que je tire essentiellement les citations de mon texte de ce soir.
On sait que, comme bon nombre de
mouvements artistiques, le jazz n’a pas échappé à un machisme souvent rampant;
jusqu’à la démocratisation des facultés de musique et à l’ouverture de
départements de jazz dans la plupart des grands collèges et universités de la
planète (surtout à partir des années 1980), il est vrai que c’était une
sous-culture aux codes très masculins. Les raisons en sont multiples et
complexes; du point de vue historique, il est utile de rappeler la manière dont
s’est d’abord développée la musique afro-américaine, art de survivance et
d’affirmation d’une identité vivace mais tragiquement déracinée, bien sûr, mais
aussi élément constituant d’un besoin de communauté incontournable à la suite
de siècles d’esclavage et au moment d’une nouvelle ségrégation qui se met en
place à la fin du XIXe siècle. Un exemple concret de cet art de la survie et de
la communauté serait le fleurissement des clubs sociaux
à la Nouvelle-Orléans, clubs qui, en échange d’une contribution de leurs
membres, pouvaient mettre leurs richesses en commun pour agir comme ressource
d’entraide; c’est l’existence de ces clubs qui est à l’origine de la longue
survie de la tradition des brass bands par exemple, puisque parmi les
fonctions du club on retrouve la prise en charge de l’enterrement de ses
membres décédés. Mais longtemps ces clubs furent réservés aux anciens soldats,
aux travailleurs, aux artisans et aux professionnels, c’est-à-dire plutôt
exclusivement aux hommes de la communauté, et jusqu’à relativement récemment,
il était très rare qu’une des fameuses «funérailles jazz» suive le cortège
d’une femme. Si cet exemple explique en partie les origines d’un fort sentiment
de fraternité masculine qui s’est répandu dans divers aspects de la vie
afro-américaine du début du XXe siècle, il ne sous-entend évidemment pas que
les femmes ne jouèrent aucun rôle dans la transmission des traditions musicales
de la communauté; le milieu familial et les célébrations religieuses, par
exemple, au sein desquelles les femmes jouaient un rôle central, sont
évidemment à la fondation même du formidable mélange culturel qui donnera
naissance, dans les dernières décennies du XIXe siècle, à ce qu’on va bientôt
appeler «jazz».
Aujourd’hui, plus d’un siècle plus
tard, la présence des femmes dans le jazz est devenue incontournable, et des
figures contemporaines comme Maria Schneider, Nicole
Mitchell, Satoko Fujii, Matana Roberts ou Mary Halvorson nous
fournissent autant d’univers musicaux originaux qui enrichissent la scène
musicale et nourrissent un champ d’abord défriché par des pionnières dont je
vais tenter ici de faire un tour d’horizon.
On notera que bon nombre des
pionnières du jazz étaient des pianistes.
Pour les classes pauvres, le piano (ou l’orgue) étaient évidemment au centre
des célébrations religieuses pratiquées dans la plupart des rites, catholiques
comme protestants; pour les familles plus aisées l’instrument était un élément
incontournable de la demeure bourgeoise (à la Nouvelle-Orléans, par exemple, on
comptait de nombreuses familles créoles, de culture plus européenne et d’une
situation économique généralement meilleure que dans les quartiers de Uptown,
les quartiers noirs, plus pauvres). On comprendra ainsi que, malgré la
réticence des parents et de la communauté en général à considérer que le métier
de musicienne (à plus forte raison musicienne de jazz!) soit approprié pour une
jeune femme, le piano est tout de même un instrument acceptable pour que les
femmes puissent pratiquer la musique. Dans certains milieux, il semble même que
le piano ait été associé à des qualités plus féminines; Jelly Roll Morton, par
exemple, mentionne que dans sa jeunesse, être pianiste était considéré comme
efféminé; lui-même ne s’y consacrera qu’après avoir vu jouer, à l’opéra créole,
un pianiste qui, pour une fois, ne portait pas les cheveux longs! (On sait que
dans le langage des jazzmen, longhair est synonyme de musicien
classique, et par extension de quelqu’un qui n’est pas très à la page, un square
finalement…).
Musique pianistique par excellence,
justement, le ragtime atteint dès les dernières
années du XIXe siècle une grande popularité, grâce entre autres à l’explosion
des ventes de partitions; nombre de jeunes filles apprenant le piano dans les
premières décennies du XXe siècle seront donc mises en contact avec cette forme
inédite de musique afro-américaine, au rythme irrésistible : mes propres
grand-mère et grand-tante jouaient dans leur jeunesse le Raggity Rag de
Jean-Baptiste Lafrenière! Mais à l’origine même de la musique, on retrouve
certaines pianistes, ou ticklers, féminines, comme Ragtime Kate
Beckham, May Irwin, ou des compositrices comme May Aufderheide, Adeline
Shepherd, Muriel Pollock, ou encore Ida Emerson, qui collaborait avec l’auteur
de chansons Joseph E. Howard; ces derniers ont écrit ensemble le succès de 1899
Hello, Ma Baby (oui, la pièce de la grenouille dans les Looney Tunes!).
Si on estime que la vogue du ragtime se termine à peu près avec la mort de
Scott Joplin en 1917, son répertoire reste objet de fascination pendant de
nombreuses années, comme en témoigne cet enregistrement
de 1921 du célèbre Maple Leaf Rag par une virtuose montréalaise
et célèbre accompagnatrice de films muets, Vera Guilaroff :
Si la popularité du ragtime était due en grande partie à la large distribution de la musique en feuilles, pour le grand public c’est encore la scène qui sera, avant l’arrivée de la radio, le principal lieu de diffusion pour la musique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c’est par le music-hall, les chansons du vaudeville, des tent shows et des minstrel shows que vont se propager les nouvelles formes musicales, souvent inspirées de la musique des anciens esclaves; bien que stéréotypées, voire parfois dégradantes pour les afro-américains, ces nouvelles formes seront toutefois réappropriées par les artistes noirs eux-mêmes. Les troupes que forment ces artistes, souvent familiales, mettent à profit tous les talents de ses membres, femmes et enfants compris! La famille Young, par exemple, était basée à Algiers, un quartier de la Nouvelle-Orléans; dirigée par le père, Billy, la troupe familiale se produisait dans les cirques et les carnavals depuis la Floride jusqu’au Minnesota. On sait que c’est au sein de cette cellule familiale singulière que se développèrent les talents de Lester Young, le Président lui-même, et de son frère, Lee, excellent batteur; mais également douées semblent avoir été leur mère, Lizetta, et leur sœur, Irma. Dans l’Oklahoma, l’orchestre de Harold ‘Doc’ Pettiford allait être une école très enrichissante pour un jeune contrebassiste qui deviendra plus tard assez célèbre, Oscar Pettiford, mais encore une fois les femmes de la famille jouaient un rôle important dans l’organisation : la mère enseignait la théorie musicale et l’harmonie, une des sœurs, Leontine, tenait le piano, jouait de plusieurs instruments à anche et s’occupait des arrangements; l’autre soeur, Marjorie, était selon Oscar lui-même une excellente saxophoniste. Au Texas, bien qu’ils n’aient jamais constitué une troupe à proprement parler, la famille Teagarden était un autre formidable incubateur, avec les frères Charlie et Jack Teagarden (qui aura plus tard la popularité que l’on sait), mais aussi les sœurs Clois, batteuse, et Norma, pianiste; cette dernière a eu une assez longue carrière, notamment dans l’orchestre de Jack dans les années 1940 et 50.
Si j’ai mentionné certaines traditions
de la Nouvelle-Orléans c'est que c'est évidemment un endroit d'importance capitale
dans l’élaboration, le métissage et l’évolution de plusieurs formes de musique
afro-américaine. L’histoire de la ville est remplie de figures
semi-légendaires hautes en couleur, et ses personnages féminins ne font pas
exception, depuis la prêtresse vaudou Marie Laveau jusqu’aux fameuses
tenancières de Storyville comme Lulu White, ou encore Antonia Gonzales, qui
attirait parfois les clients en jouant du cornet. Chanteuse de blues au
répertoire limité (elle ne connaissait apparemment qu’une seule chanson), Mamie
Desdoumes était une autre habituée du District, s’accompagnant au piano
des trois doigts qui restaient à sa main droite. Plus tard, Jelly Roll Morton
l’immortalisera en endisquant Mamie’s Blues (qu’on connait aussi sous le titre 2:19 Blues).
Baignées dans l’atmosphère très musicale de la Cité du Croissant, quelques
femmes, encore une fois majoritairement des pianistes, vont tenter d’intégrer
la très serrée «fraternité» des musiciens néo-orléanais; je vous en présente
trois ici qui auront quand même d’assez longues carrières.
La doyenne du groupe est celle qu’on
surnommait ‘Sweet Emma’, et éventuellement ‘The
Bell Gal’, parce qu’elle accompagnait son jeu de piano et ses chansons de
clochettes attachées ses jarretières. Emma Barrett était née en 1897,
et, dotée d’une oreille exceptionnelle, son apprentissage musical fut largement
autodidacte. Rejoignant l’Original Tuxedo Orchestra de Papa Celestin en 1923,
elle suit ensuite son co-leader, William ‘Bebe’ Ridgley, au sein d’une nouvelle
édition de cet orchestre. Développant un jeu de piano vigoureux et un style
vocal inspiré des chanteuses de blues de l’ère classique, Sweet Emma devient à
partir de la fin des années 1950 une des figures les plus populaires du jazz
traditionnel de la Nouvelle-Orléans, participant à la fondation du Preservation
Hall, et réalisant quelques disques typiques et prisés par les touristes.
Souffrant d’un AVC en 1967, elle reste cependant active, et on la verra
régulièrement, la tête toujours coiffée de son inséparable bonnet rouge, au
Preservation Hall, jusqu’à peu de temps avant sa mort, en 1983, après une
carrière qui a couvert plus de six décennies!
Celle qui devait succéder à Sweet Emma
au sein de l’Original Tuxedo Orchestra sera Jeanette
Salvant. Née en 1906 dans le Mississippi, elle joue du piano dans sa
jeunesse à l’église et à l’école; son oncle était le pianiste de blues Tuts
Washington. Remarquée par Papa Celestin lors d’une audition de lecture à vue,
elle restera au sein du Tuxedo jusqu’en 1935, enregistrant avec l’orchestre
pour Columbia entre 1926 et 1928. Mariée au banjoïste de l’orchestre, Narvin
Kimball, elle quitte temporairement la musique pour élever ses enfants, mais
elle continue de se produire à l’occasion, et elle rejoint l’orchestre de
Celestin dans les années 50. Après la mort du leader, elle demeure au sein du
Tuxedo sous la direction de Albert ‘Papa’ French, et collabore avec de
nombreuses figures du jazz de la Nouvelle-Orléans, comme Paul Barbarin, Kid
Thomas ou le Preservation Hall Jazz Band. Quittant la Nouvelle-Orléans dans les
années 1990, elle est décédée en Caroline du Sud en 2001, à l’âge de 94 ans.
Je vous ai préparé un petit montage où
on peut voir, d’abord Sweet Emma Barrett avec une brochette de vétérans pour
une émission spéciale du Art Ford’s Jazz Party en 1958, puis Jeanette Kimball
au sein de l’Original Tuxedo Jazz Band en 1964 :
Une troisième pianiste, également
chanteuse de blues, de la Nouvelle-Orléans, Billie
Pierce. Née Wilhelmina Madison Goodson en Floride en 1907, elle suit
l’exemple de son père, sa mère et ses cinq sœurs, qui chantent et jouent tous du
piano, notamment au sein de l’église baptiste. Très religieux, ses parents
désapprouvent la curiosité de leurs filles pour la musique de danse, le ragtime
ou le blues, mais les sœurs trouvent quand même le moyen de se faufiler pour
entendre les groupes de passage. Billie a 13 ans lorsqu’elle remplace, au pied
levé, l’accompagnateur de Bessie Smith; elle en a à peine 15 lorsqu’elle adopte
le mode de vie d’une musicienne et part sur la route avec une série de troupes
de carnaval et de ces orchestres locaux qu’on nomme alors Territory Bands. En
1929, au moment de la crise, elle se rend à la Nouvelle-Orléans pour remplacer
sa sœur malade, qui avait trouvé un engagement avec Buddy Petit sur un des
fameux bateaux à vapeur qui faisaient excursion sur le lac Pontchartrain. Elle
décide de rester dans la ville, épousant en 1935 le trompettiste et chanteur
créole De De Pierce; les deux formeront un duo familier, fidèle à l’esprit du
blues classique (dans lequel excellait Billie), enrichissant leur répertoire de
chansons créoles (spécialités de De De), toujours sur fond du piano de Billie
Pierce, typiquement barrelhouse. Familiers du Luthjen’s Dance Hall
pendant près d’un quart de siècle, Billie et De De ont représenté une
institution incontournable de la Nouvelle-Orléans, réalisant plusieurs disques
à partir des années 1950. Billie Pierce est décédée en 1974, quelques mois
après De De.
-------
Les différentes migrations de
musiciens de la Nouvelle-Orléans et du Sud en général ont été assez largement
étudiées par les historiens du jazz; attirés par un climat racial moins hostile
et de meilleures opportunités de travail, plusieurs musiciens rejoindront la
Californie ou New York, mais surtout Chicago, où
on retrouve, au début des années 1920, des figures majeures comme Freddie
Keppard, Jelly Roll Morton, les frères Johnny et Baby Dodds, Kid Ory et King Oliver. On sait l’impact
qu’aura ce dernier avec son Creole Jazz Band, qui réunit le vétéran cornettiste
avec son protégé, un jeune homme grassouillet fringué comme un paysan qui
débarque tout juste de Louisiane, un certain… Louis Armstrong! Il n’a rien pour
impressionner la pianiste du groupe, qui reconnaît
cependant assez vite ses qualités exceptionnelles de musicien. De trois ans
l’aînée du jeune Louis, Lil Hardin était née à Memphis en 1898; d’abord
employée comme démonstratrice dans un magasin de musique sur State Street à
Chicago, elle fera l’apprentissage du jazz à la dure lorsqu’elle auditionne
pour un groupe de néo-orléanais dirigé par le clarinettiste Lawrence Duhé; voici
comment elle décrit la rencontre : «Ils m’ont poliment expliqué qu’ils
n’avaient pas de partitions, et qu’ils n’en utilisaient jamais. Je leur ai
alors demandé dans quelle tonalité serait le premier morceau. J’aurais aussi
bien pu parler une autre langue, parce que le leader m’a répondu :
« Quand tu entends deux coups, commence à jouer!»». Chez Oliver, la
pianiste joue un rôle assez important : c’est elle qui se charge de
transcrire les arrangements du groupe, y compris les fameux breaks à
deux cornets avec lesquels Oliver et Armstrong régalent le public aux Lincoln
Gardens et qui seront immortalisés sur une série de disques célèbres pour
Gennett en 1923.
Épousant Louis Armstrong en 1924, Lil va prendre la carrière du trompettiste en main; c’est elle qui le pousse à quitter l’orchestre d’Oliver pour rejoindre New York et l’orchestre de Fletcher Henderson. De retour à Chicago, elle joue aussi un rôle important dans la série d’enregistrements réalisés par Louis à cette époque, les fameux Hot Fives et Hot Sevens, contribuant quelques compositions devenues célèbres, dont Struttin’ with Some Barbecue. Si son jeu de piano a souvent été jugé inégal sur cette série avec Louis, on peut mieux l’apprécier sur une autre série de disques de la même époque avec les New Orleans Wanderers et les New Orleans Bootblacks, pour Columbia en 1926. C’est le tromboniste Preston Jackson qui la décrit le mieux : «Lil n’a jamais été éclatante. Elle est une bonne soliste et elle accompagne solidement, quatre accords par mesure, tel que prescrit par le docteur! Quand vous mettez un des disques par Louis Armstrong, un des disques du Hot Five, écoutez la base, le fondement. Ça devient évident.» Autrement dit, Hardin n’est pas une pianiste «orchestrale» comme pouvait l’être par exemple Jelly Roll Morton, qui était pourtant une de ses influences avouées.
Si Lil Hardin
Armstrong se sépare de Louis dans les années 1930, elle va rester proche
de Satchmo jusqu’à la mort de ce dernier. Elle approfondit ses études de
musique, dirige un All Girl Orchestra à la NBC, puis entre chez Decca, où elle
accompagne divers chanteuses et chanteurs de blues (notamment Alberta Hunter),
en plus de réaliser plusieurs disques avec ses propres petits groupes, qui
mettent de l’avant ses qualités de chanteuse; parmi ses sidemen, on retrouve des solistes Swing
comme Chu Berry, Buster Bailey et Jonah Jones. Elle abandonne momentanément la
musique à la fin des années 1940 et se fixe de nouveau à Chicago. Un bref
passage en Europe, au début des années 1950, lui
permet de réaliser une session en trio avec Sidney Bechet et Zutty Singleton.
En 1957, elle enregistre un disque de souvenirs pour Riverside, label qui
l’inclut également quelques années plus tard dans sa série
Chicago : The Living Legends. Peu après la mort de Louis, en
1971, elle participe à une émission télévisée en hommage à celui dont elle
avait pratiquement lancé la carrière près de 50 ans plus tôt; mais au cours du
programme, elle est victime d’un malaise cardiaque et décède avant d’arriver à
l’hôpital; elle avait 73 ans.
On peut voir Lil Hardin Armstrong dans
cet extrait de l’émission Chicago and All That Jazz, diffusée par la NBC
en 1961; elle y interprète une version de la composition de Jelly Roll Morton, The
Pearls, puis accompagne Mae Barnes, Henry ‘Red’ Allen et Buster Bailey sur
un vieux classique des Hot Fives, Heebie Jeebies :
Si Lil Hardin a été très visible grâce
à son association à King Oliver et Louis Armstrong, elle n’a pas été la seule
pianiste d’importance issue de la scène de Chicago; d’égale importance au moins
aura été Lovie Austin, active à la même
époque. Née dans le Tennessee en 1887 sous le nom de Cora Taylor, elle adoptera
ensuite le nom de famille Calhoun, d’après son premier mari, puis celui de
Austin, d’après son deuxième mari, un artiste de vaudeville avec qui elle part
en tournée; elle sera également accompagnatrice de plusieurs chanteuses de
blues. Fixée à Chicago en 1923, elle y monte ses propres revues, dont la Lovie
Austin’s Revue, qu’elle mène en 1926 jusqu’à New York, au Club Alabam. Elle
devient également une des pianistes maison de l’étiquette Paramount, organisant son propre groupe, les Blues
Serenaders, pour accompagner certaines des chanteuses les plus populaires de
cette première «ère du blues» sur disque, notamment Ida Cox, Alberta Hunter, Ma
Rainey, et même Ethel Waters, en plus de laisser une douzaine de faces instrumentales où s’illustrent Tommy Ladnier,
Johnny Dodds, Kid Ory ou encore Natty Dominique. On peut se faire une bonne
idée de son jeu de piano à son apogée en écoutant son accompagnement à Ladnier
et au clarinettiste Jimmy O’Bryant sur une composition de Austin enregistrée en
novembre 1924, Traveling Blues :
Pendant une vingtaine d’années, Lovie Austin sera aussi cheffe d’orchestre, arrangeuse
et directrice musicale dans la fosse du Monogram Theater à Chicago, et c’est
dans ce rôle qu’elle va marquer une autre femme de jazz importante, Mary Lou
Williams, qui se rappelle l’avoir vue dans un théâtre à Pittsburgh dans sa
jeunesse :
«Je me
souviens avoir vu cette femme géniale assise dans la fosse, dirigeant un groupe
de six hommes, les jambes croisées et la cigarette au bec, accompagnant le
spectacle de la main gauche et écrivant la musique du prochain numéro de la
main droite. Wow! Ma conception est entièrement basée sur les quelques
rencontres que j’ai eues avec Lovie Austin.»
Mais l’arrivée de la guerre va priver
Lovie Austin de bons musiciens et elle devra abandonner momentanément la
musique, se faisant gardienne de sécurité dans une usine militaire. Après la
guerre, elle sera pianiste dans une école de
danse, mais elle retrouve à l’occasion ses fonctions d’accompagnatrice de
chanteuses de blues, notamment avec Chippie Hill; comme Lil Armstrong, elle
fera partie de la série Chicago : The Living
Legends pour l’étiquette Riverside au début des années 1960 :
pour l’occasion, elle retrouve Alberta Hunter. Lovie Austin est décédée à
Chicago en 1972, à l’âge de 84 ans.
À Chicago et dans le Midwest, dans les
années 1920 et 1930, on peut retrouver nombre de pionnières dont la plupart ne
nous sont connues que de nom et de réputation; on aura compris que les traces
discographiques de cette époque sont rares, à l’image des difficultés que les
instrumentistes féminines vont rencontrer tout au long de l’histoire du jazz,
difficultés dont on peut retrouver des traces encore aujourd’hui. Mais nous y
reviendrons.
Mentionnons ici les pianistes Irene Armstrong (plus
tard épouse de Teddy Wilson, et autrice sous le nom de Irene Kitchings de Some
Other Spring, qu’interprétera son amie Billie Holiday); Lil ‘Diamonds’ Hardaway, également chanteuse de
blues, avait déjà accompagné Ma Rainey sous le nom de Lil Henderson; elle a
gravé quelques faces pour Vocalion en 1928 et, avec ses Gems of Rhythm, pour
Decca en 1936; Mabel Horsey, dont on sait très peu de choses, a laissé
avec son Hot Five deux faces intéressantes pour Gennett en 1928; et Georgia
Corham qui a dirigé son propre orchestre, les Syncopators, et été une
accompagnatrice pour le célèbre label Black Swan. Parmi les musiciennes blanches
de Chicago, comptons la contrebassiste Thelma Terry,
qui a laissé six faces avec ses Playboys, dont faisait partie un jeune Gene
Krupa. Également de Chicago, la trompettiste Dolly
Jones sera aussi connue sous les noms
de Doli Armenra et Dolly Hutchinson; sa mère, Diyaw Jones était une
trompettiste de renom qui a aussi enseigné à Valaida Snow (dont nous parlerons
plus tard) : mère et fille font partie de la troupe familiale. Dans les
années 1920, elle fait partie des Three Classy Misses avec Irene Armstrong et
la violoniste Kathryn Perry; elle sera la première femme trompettiste à
enregistrer un solo de jazz hot avec le Gutbucket Five du tromboniste de
la Nouvelle-Orléans, Albert Wynn. Elle fera ensuite partie des Harlem Harlicans
de Lil Armstrong, et dans les années 1930 elle apparait dans un film du pionnier
du cinéma afro-américain, Oscar Micheaux, dont je tire ce petit montage :
Mais la figure majeure du jazz du
Midwest, et probablement la plus importante instrumentiste, compositrice et
arrangeuse féminine de l’histoire du jazz, c’est évidemment Mary Lou Williams. Née à Atlanta, celle qui
s’appelle d’abord Mary Elfrieda Scruggs, puis Burleigh d’après son beau-père,
grandit à Pittsburgh; dès l’âge de six ans, elle divertit les voisins avec son
talent précoce de pianiste. Jeune adolescente, elle est déjà sur la route avec
des troupes de vaudeville, de cirque et de carnavals. Elle rencontre bientôt un
saxophoniste nommé John Williams, qui va souvent prendre sa défense face à des
gérants et des artistes réticents à engager une femme pianiste; elle épouse
Williams en 1927, et les deux seront actifs à Memphis à cette époque. Plus tard
la même année, le couple déménage à Oklahoma City, et c’est là qu’ils
participeront à la genèse d’un des orchestres les plus distingués du jazz du
Midwest, qui prendra bientôt le nom de Andy Kirk and his Twelve Clouds of Joy. Dans
les premières années, Mary Lou n'est
officiellement que la chauffeuse de l’orchestre, mais, dit-elle, «si les choses
allaient mal et que les gens ne dansaient pas, ils envoyaient quelqu’un me
chercher et je rentrais jouer Froggy Bottom ou un autre boogie woogie –
et là ça se mettait à bouger!». En 1931, elle est officiellement compositrice
et arrangeuse pour l’orchestre, et les producteurs insistent pour que ce soit
elle qui apparaisse sur les enregistrements des Clouds of Joy; en 1930, elle
avait déjà gravé une paire de ses propres compositions en solo pour Brunswick,
dont ce Night Life :
À la fin de 1931, Williams devient
finalement membre à temps plein de l’orchestre
de Andy Kirk; c’est surtout elle qui sera derrière le succès de l’orchestre
dans les années 1930, fournissant des compositions et des arrangements dans le
meilleur style Kansas City, notamment Walkin’ and Swingin’, Mary’s
Idea et Little Joe from Chicago, en plus d’une pièce de Cahn et
Chaplin qui lui reste associée, The Lady Who Swings the Band! Parallèlement,
elle écrit des arrangements pour certains des orchestres les plus populaires de
la Swing Era, comme ceux de Earl Hines, Tommy Dorsey et Benny Goodman; ce
dernier, devant le succès de la pièce de Williams Roll ‘em, tente d’obtenir
d’elle un contrat exclusif mais cette dernière refuse, préférant demeurer avec
les Clouds of Joy. Par contre, Mary Lou Williams sera bientôt victime de son
hyperactivité; fatiguée de la route, elle quitte les Clouds of Joy en 1942 et
divorce de John Williams; nous retrouverons Mary Lou plus tard pour ses
activités à partir des années 1940.
Si elle est d’abord une chanteuse, Blanche Calloway a
aussi été une cheffe d’orchestre importante dès les années 1920. En 1931, on
lui impose la direction d’orchestres véritablement dirigés par le trompettiste
Charlie Gaines, puis par Andy Kirk; mais elle forme bientôt son propre
orchestre, Blanche Calloway and her Joy Boys, un des meilleurs de son temps, où
on retrouve des musiciens comme Ben Webster, Vic Dickenson, Clyde Hart et Cozy
Cole. Mais les conventions de l’époque jouent contre cet orchestre dont le
leader est une femme, et la puissante agence de Irving Mills, qui avait déjà
lancé Duke Ellington, lui préférera pour remplacer le Duke au prestigieux
Cotton Club le propre frère de Blanche, Cab Calloway… En 1938, Blanche Calloway
doit déclarer banqueroute; elle sera plus tard gérante de la chanteuse Ruth
Brown, entre autres, mais elle n’atteindra jamais le statut auquel son talent
lui aurait donné droit.
De la même façon, si on se souvient
aujourd’hui du nom de Leora Meoux (ou Meaux)
Henderson, c’est principalement par sa participation à l’orchestre
de son mari, Fletcher Henderson, auprès duquel elle a tenu le rôle
d’arrangeuse, de gérante de tournée, et occasionnellement de remplaçante au
sein des sections de trompettes et de saxophones. Mais Leora dirigea aussi son
propre orchestre féminin, les Vampires, qui apparut entre autres parallèlement
à l’orchestre de Fletcher au Roseland Ballroom vers 1927; elle participera
aussi à l’orchestre féminin dirigé par Lil Armstrong au début des années 1930.
Si Leora Meoux n’était pas d’abord une trompettiste improvisatrice, de son
propre aveu, elle viendra au jazz au contact de Louis Armstrong lorsque
celui-ci fait partie de l’orchestre de Fletcher en 1924, comme nombre des
autres musiciens du célèbre big band.
Dans les années 1930, les femmes instrumentistes sont encore assez rares,
même au sein des importantes cohortes de ces big bands qui vont bientôt
pulluler après le succès de Benny Goodman en 1935. C’est au sein de la culture
des jam sessions intenses de Kansas City qu’on retrouve la pianiste Margaret
Johnson, dite ‘Countess’ ou ‘Queenie’. Membre de l’orchestre de Harlan
Leonard et amie de Lester Young, Johnson n’a laissé qu’une seule session, au
sein de l’orchestre de Billie Holiday en 1938. Remplaçant Mary Lou Williams
dans les Clouds of Joy en 1939, Johnson succombe à la tuberculose la même
année, âgée d’à peine 20 ans…
L’histoire de Valaida Snow est
moins brève mais pas moins tragique. Née en 1904 au sein d’une famille de
musiciens, Snow est déjà en vedette dans les clubs de Philadelphie et Atlantic
City à l’âge de 16 ans. Trompettiste virtuose, son style brillant et ses
talents d’amuseuse (elle est aussi une chanteuse de talent et une danseuse
complète) lui vaudront le surnom de ‘Little Louis’, en référence à Armstrong. Sa
carrière la mènera vite un peu partout dans le monde : dès 1926, elle fait
partie des Serenaders du batteur Jack Carter, qui se rendent en Chine, à
Singapour, en Inde et en Indonésie! Quelques années plus tard, elle se rend en
URSS, au Moyen Orient et en Europe; elle grave ses premiers disques à Chicago
en 1933, accompagnée par l’orchestre de Earl Hines. Elle apparait dans des
films à Hollywood et se retrouve en vedette de l’Apollo Theatre, mais elle
trouve sans doute la vie européenne moins
contraignante, et on la retrouve surtout à Londres et à Paris, où on l’aperçoit
dans quelques classiques cinématographiques du réalisme poétique, L’Alibi de
Pierre Chenal, et Pièges de Robert Siodmak. C’est au cours de son séjour
en Scandinavie, en 1940, que la guerre la rattrape, lors de l’invasion
allemande du Danemark. Accusée de vol et de possession de drogue, elle est
emprisonnée dans une prison danoise administrée par les nazis pendant deux ans;
l’expérience laissera des traces indélébiles chez Snow, et malgré un retour à l’Apollo en 1943, elle ne
retrouvera jamais sa stature d’avant-guerre. Valaida Snow est décédée d’une
hémorragie cérébrale en 1956, âgée d’à peine 51 ans. Je vous fais écouter Valaida
Snow à son meilleur dans cette version du St. Louis Blues de W.C. Handy,
gravé au Danemark en 1940 avec l’orchestre du saxophoniste Winstrup Olesen :
On aura compris que les femmes
instrumentistes sont encore assez rares à l’ère du Swing, même si on aurait pu
penser que les cohortes des big bands de 12 ou 15 musiciens auraient eu besoin
de l’ajout du talent des musiciennes actives dans les années 1930 et 40; le
machisme y est évidemment pour beaucoup : un chef d’orchestre célèbre
comme Buddy Rich déclarera par exemple : «je n’engagerai jamais une
poulette (chick) dans mon orchestre». Mais tous ne sont pas nécessairement de l’avis
de Rich; Woody Herman par exemple engage la trompettiste Billie Rogers en 1941, la trompettiste dirigera deux ans plus tard son propre orchestre.
Après un séjour chez Jerry Wald, puis à la tête d’un sextette, Rogers quitte la
musique en 1947. D’abord remarquée dès les années 1930 dans le big band de Mike
Riley, la saxophoniste L’ana Webster referra
surface dans les années 1940 sous le nom de L’ana Hyams au sein des Hip Chicks
avec sa belle-sœur, la vibraphoniste Margie Hyams. Un peu plus tard, dans les
années 1950, la saxophoniste Elsie Smith rejoindra le big band de Lionel Hampton, prenant la
relève de solistes considérés comme plutôt virils, en l’occurence Illinois
Jacquet, Arnett Cobb et Eddie Chamblee.
Une vogue inattendue va bientôt
relativiser cette misogynie ambiante : celle des orchestres féminins, qui
se multiplieront à partir du milieu des années 1930. Mais le phénomène n’était pas
nouveau : dès les dernières décennies du XIXe siècle, certaines troupes de
minstrels, de vaudeville et certaines fanfares sont parfois composées
uniquement de femmes. Une pionnière de la musique de scène, Marie Lucas était
tromboniste, pianiste et arrangeuse, fille d’une des légendes du music-hall, le
chanteur de minstrel shows et de vaudeville Sam Lucas. En 1915, après la
mort de son père, elle dirige le Lafayette Ladies’ Orchestra, mais aussi des
orchestres masculins, un peu partout sur la Côte Est, tout au long des années
1910 et 1920. J’ai déjà mentionné les orchestres féminins dirigés par Leora
Meoux Henderson et Lil Hardin Armstrong, mais pour ces quelques formations de
valeur, on en trouvait autant qui n’étaient pas grand-chose de plus que des
coups un peu fumeux, des gimmicks d’agents d’artistes en manque d’idées
originales. Par contre, un des gérants plus sérieux, Irving Mills, qui avait
déjà lancé Duke Ellington et Cab Calloway, fonde en 1934 un orchestre mixte (hommes et
femmes) intéressant mais éphémère, le Mills Cavalcade Orchestra. La même année,
Mills est sollicité par le promoteur Alex Hyde, qui le convainc de monter un
orchestre qui sera cette fois exclusivement féminin, Ina Ray Hutton and the Melodears. Ina Ray Hutton était un nom
de scène utilisé par Odessa Cowan, ancienne danseuse et chorus girl des
Ziegfeld Follies; surnommée la Blonde Bombshell of Rhythm, on comptera sur ses
charmes pour promouvoir les Melodears; mais au-delà de son image de jolie
blonde qui fait mine de diriger sa cohorte, Hutton s’est affirmée comme une
bonne chanteuse et une danseuse de talent. Quant à l’orchestre, on pourra se
rendre compte de son excellent niveau dans cet extrait filmé de 1936 (on
remarquera le court solo de la guitariste, qui rappelle un peu Eddie
Lang) :
Les Melodears vont exister jusqu’en
1939; Hutton continuera sa carrière avec un orchestre masculin, avant de
reformer un big band féminin en 1949, qui apparaîtra dans sa propre émission de
télévision, le Ina Ray Hutton Show, dans les années 1950. Hutton prendra
sa retraite de la scène en 1968, elle est décédée en 1984.
Parmi les autres orchestres féminins
de la Swing Era, on peut citer les groupes dirigés par la pianiste Elinor
Sten (Elinor and her Smoothies), par la trompettiste Louise Sorenson
(les Ingenues, basées à Chicago – on pense au film Some
Like It Hot – et qui se rendront jusqu’en Australie!), par Ada Leonard (dont
l’orchestre allait divertir les soldats américains pendant la guerre), ou
encore par Rita Rio, qui sera connue plus
tard au cinéma sous le nom de Dona Drake. Mentionnons aussi Frances Carroll et ses
Coquettes, qui mettaient en vedette la batteuse Viola Smith, qui est
restée active presque jusqu’à sa mort en 2020, à l’âge de… 107 ans! Les
orchestres dont j’ai parlé jusqu’à présent étaient majoritairement composés de
femmes blanches; à cette époque de ségrégation raciale, hélas, peu de groupes
étaient mixtes… Des orchestres de femmes noires vont cependant aussi voir le
jour, notamment les Harlem Playgirls, dès
1935; celles-ci sauront étonner un public d’abord sceptique lors de leur
passage au légendaire Savoy Ballroom en 1938.
Mais l’orchestre féminin le plus
remarquable de l’ère du Swing, à plusieurs niveaux, aura des origines
surprenantes : c’est pour récolter des fonds pour une école du Mississippi
accueillant des orphelines, la Piney Woods School, que se forment d’abord les International Sweethearts of Rhythm, modelées sur
les Melodears de Ina Ray Hutton, mais avec des élèves de Piney Woods, en
majorité des afro-américaines mais aussi des jeunes filles d’origine asiatique
ou latino-américaine. Le directeur de l’école, Laurence C. Jones, cherche à
recruter des musiciennes talentueuses de toutes origines, et l’orchestre fait
bientôt parler de lui un peu partout. En 1941, les Sweethearts
commencent à tourner sérieusement. Avec l’entrée en guerre des USA et le
départ de plusieurs hommes pour leur service militaire, on connaît le nouveau
rôle dévolu à bien des femmes qui entrent désormais dans le monde du travail
pour pallier ces départs et aussi pour participer à l’effort de guerre; pour
les big bands, la situation est semblable et il se trouve soudainement un
espace inédit pour qu’un orchestre comme les Sweethearts of Rhythm se taille
une place sur le devant de la scène. C’est la chanteuse Anna Mae Winburn qui en assumera alors la direction, les arrangements
étant confiés d’abord à Eddie Durham (qui formera bientôt son propre All-Star
Girls Orchestra), puis à Jesse Stone. Ce dernier va recruter quelques
musiciennes professionnelles pour permettre à l’orchestre d’atteindre un
meilleur niveau, et aux autres membres d’acquérir de l’expérience à leur
contact. Parmi ces nouvelles solistes, mentionnons deux des vedettes des
Sweethearts, la trompettiste et chanteuse Ernestine
‘Tiny’ Davis, et la saxophoniste Violet ‘Vi’ Burnside. L’orchestre se
produit surtout dans les quartiers afro-américains, et la présence de
musiciennes blanches au sein du groupe va évidemment causer des frictions lors
des passages des Sweethearts dans le Sud des USA (même
au sein des orchestres d’hommes, la mixité raciale était extrêmement rare à
cette époque). Jusqu’à la fin des années 1940, les Sweethearts, dont
l’arrangeur était désormais Maurice King, conserveront une grande popularité
dans les quartiers Noirs, n’hésitant pas à affronter à l’occasion d’autres orchestres prestigieux, comme ceux de
Fletcher Henderson, Erskine Hawkins ou Earl Hines (on dit d’ailleurs que Hines,
comme Jimmie Lunceford, étaient très enthousiastes à propos des qualités
évidentes des Sweethearts). Parmi les musiciennes qui passèrent par les rangs
de cette institution unique durant la dizaine d’années que dura son aventure,
on retrouve, en plus de Davis et Burnside, Edna Williams (trompette), Roz Cron
et Willie Mae Lee Wong (saxophones), Lucille Dixon (contrebasse) ou Pauline Braddy
(batterie). Voici deux extraits des Sweethearts, tirés de courts métrages
auxquels elles ont participé, d’abord la pièce She’s Crazy with the Heat,
où on entend Vi Burnside et probablement Ray Carter (trompette), puis un
extrait de How About That Jive, où on peut voir Tiny Davis dans une finale
parodiant celles de Louis Armstrong :
On peut voir sur YouTube un bon documentaire d’une demi-heure sur les International Sweethearts of Rhythm, avec des entrevues de plusieurs des anciennes membres de l’orchestre, réalisé en 1986.
-------
La popularité des Melodears et des
Sweethearts va permettre l’éclosion d’autres orchestres féminins un peu partout
dans le monde, jusqu’au Japon et même en URSS! En Angleterre, Ivy Benson dirige
dans les années 1940 un Girls’ Band qui sera l’orchestre de danse en résidence
de la BBC pendant la guerre.
Après la fin du conflit mondial par
contre, les goûts du public vont changer, et la plupart des big bands vont
disparaître. Dans les cabarets des années 1940 et 1950, ce seront plutôt les
artistes solo ou les petites formations qui auront la cote, à commencer par les
pianistes. C’est là qu’on va retrouver, par exemple, Mary Lou Williams. Ayant quitté l’orchestre de Andy Kirk, elle
épouse le trompettiste Harold ‘Shorty’ Baker, avec qui elle rejoint
l’organisation de Duke Ellington, pour lequel elle écrit des arrangements dans
les années 1940. Mais Williams est aussi curieuse des nouvelles formes
musicales qui éclosent alors à New York; elle se fait un peu la marraine des jeunes musiciens modernes, Thelonious
Monk, Bud Powell et Tadd Dameron par exemple. Pour l’orchestre de Dizzy Gillespie, elle écrit
le conte bebop In the Land of Oo-Bla-Dee, mais son œuvre majeure à cette
époque est la Zodiac Suite, basée sur les douze signes du zodiaque,
chaque mouvement dédié à un de ses amis musiciens. Enregistrée pour Moe Asch en
juin 1945, la suite est présentée avec orchestre à Town Hall en décembre. En
voici deux extraits, le premier illustrant son propre signe, le taureau, et le
second dédié à celles qu’elle décrit comme «mes amies les bombes», l’actrice
Imogene Coca, la chanteuse Ethel Waters et la danseuse Katherine Dunham :
Williams enregistre d’ailleurs
abondamment pour Asch dans les années 1940, en solo
et avec de petits groupes, et elle dirige aussi ses propres groupes féminins
(trios, quartettes, quintettes), notamment avec la vibraphoniste Margie Hyams
et la guitariste Mary Osborne. Mais bientôt, devant une certaine frustration face
à la manière dont elle est souvent reléguée à sa vieille image de pianiste de
boogie-woogie, Mary Lou Williams se rend à Londres en 1952; elle va rester deux ans sur le Vieux Continent, surtout à Paris; elle
y enregistre en compagnie d’autres expatriés américains, par exemple Don Byas
ou l’ancien trompettiste de Duke Ellington, Nelson Williams. Mais elle vit
alors un certain désabusement, et décide d’abandonner la musique en 1954 pour
se retirer dans la campagne française; nous reprendrons l’histoire de Mary Lou
Williams plus loin…
Parmi les instrumentistes qui seront
actives dans l’après-guerre, mentionnons la contrebassiste Vivien Garry, qui sera surtout connue pour avoir
dirigé ses propres groupes, notamment avec son mari, le guitariste Arvin
Garrison, mais aussi un quintette féminin avec l’ancienne trompettiste des
Sweethearts of Rhythm, Edna Williams. La vibraphoniste Marjorie (ou Margie) Hyams
s’est fait connaître au sein des orchestres de Woody Herman et Flip
Phillips dans les années 1940; elle dirige ensuite son propre trio en plus
d’enregistrer avec deux groupes féminins, les Hip Chicks et les Girl Stars de
Mary Lou Williams. Elle rejoint le fameux quintette de George Shearing en 1949,
mais elle abandonne la musique l’année suivante suite à son mariage.
La réalité de beaucoup de femmes
instrumentistes dans l’univers des cabarets de
l’après-guerre fera que nombre de celles-ci devront aussi être chanteuses pour
pouvoir percer; on peut imaginer que comme la grande majorité des femmes de
jazz étaient chanteuses, le public s’attendait à ce qu’une femme en vedette
pousse un peu la chanson (ce qui peut nous sembler idiot aujourd’hui, mais qui
était certainement la réalité de cette époque); d’autre part, on considérait
souvent une instrumentiste féminine comme une «attraction» (attitude qui durera
très tard, bien après que des pionnières aient prouvé leurs talents
d’instrumentistes, hélas), ce qui pouvait impliquer la démonstration de
plusieurs talents, soit de danseuse ou de chanteuse (on remarquera par exemple,
dans les films de l’époque, qu’on mettait beaucoup plus l’accent sur les
qualités vocales des vedettes issues du monde du jazz, qu’elles soient hommes
ou femmes).
Parmi les pianistes qui s’illustrèrent
aussi comme chanteuses dans les années 1940 et 1950, mentionnons par exemple Julia Lee; d’abord active à Kansas City dans les
années 1920 et 1930 comme chanteuse dans l’orchestre de son frère, George E.
Lee, elle atteint une grande popularité avec ses disques des années 1940 pour
Capitol, notamment quelques chansons «risquées» (pas nécessairement
«cochonnes», mais avec des sous-entendus un peu grivois). Ses disques de cette
époque ne nous permettent pas tant d’apprécier son jeu de piano solide, infusé
de boogie woogie. Excellente dans ce style était Cleo
Brown, qui avait été influencée par le grand pianiste de boogie Pinetop
Smith; spécialiste des chansons humoristiques, on l’a parfois comparée à Fats
Waller, à qui elle fait effectivement un peu penser sur ce Pelican Stomp
entièrement instrumental gravé en 1935 pour Decca :
Une autre pianiste et chanteuse qu’on
a associée à Fats Waller, qui l’avait découverte alors qu’elle n’avait que 17
ans, Una Mae Carlisle a gravé plusieurs faces pour Bluebird, puis pour Joe
Davis, avant d’animer son propre Una Mae Carlisle Radio Show. Du côté du
boogie woogie, on retrouve Hadda Brooks,
qui eut une longue carrière qui allait la mener jusqu’en Australie, et dans les
clubs de Hollywood et New York au-delà de son 80e anniversaire. Située
pour sa part entre le jazz et le R&B naissant, Nellie
Lutcher était une autre
pianiste-chanteuse qui a influencé Nina Simone, entre autres; pour son jeu de
piano, elle s’était fortement inspirée de Nat ‘King’ Cole, avec qui elle a
enregistré quelques duos. À la fois pianiste et vibraphoniste, Dardanelle Breckenbridge a notamment enregistré avec Lionel Hampton, avec qui elle
apparaissait parfois au Cafe Zanzibar; elle dirigea son propre trio dès
les années 1940. Pianiste virtuose, Hazel Scott livrait parfois des performances plutôt étourdissantes où elle jouait de deux pianos à la fois. Apparaissant dans plusieurs
films hollywoodiens, elle avait aussi la réputation d’être une artiste engagée;
mariée au révérend Adam Clayton Powell Jr., Scott était une militante des
droits civiques et s’était élevée contre le maccarthysme. En 1955, elle grave un
disque pour le label de Charles Mingus et Max Roach, Debut; deux ans plus tard,
face au climat politique répressif aux USA, elle s’installe en France. Revenue en
Amérique en 1967, Hazel Scott est décédée en 1981. Comme Scott, Dorothy Donegan pouvait
jouer autant Rachmaninoff que du piano stride; on raconte que Art Tatum avait
déclaré à son sujet qu’elle était la seule femme pianiste dont le jeu pouvait
le motiver à rentrer pratiquer! Beryl Booker s’était fait connaître au sein du trio du
contrebassiste Slam Stewart dans les années 1940; accompagnatrice de Dinah
Washington, elle dirigea son propre groupe au Birdland pendant un temps avant
de fonder un trio féminin avec la contrebassiste Bonnie Wetzel et la batteuse
Elaine Leighton. Après un passage en Europe, où son trio accompagne Billie
Holiday et enregistre avec Don Byas, Booker accompagne de nouveau Dinah
Washington avant de disparaître de l’avant-scène; elle est apparemment restée
active sur la scène de Philadelphie jusqu’à sa mort en 1978. Si Barbara Carroll avait
été une des premières instrumentistes féminines à adopter le langage bop, elle
a aussi été une habituée des clubs huppés comme le Embers à New York. Si sa
carrière a connu un passage difficile dans les années 1960, elle a été relancée
dans les années 1970, et Carroll est restée active au-delà de son 90e
anniversaire; elle est décédée en 2017. Longtemps associée à son deuxième mari,
le contrebassiste Milt Abel, Bettye Miller a fréquenté les clubs de Kansas City
dans les années 1950 avant d’être en vedette elle aussi au Embers et à Las
Vegas; elle est morte du cancer en 1977.
Les pianistes des années 1940 et 50 ne
seront pas les seules musiciennes à s’illustrer comme chanteuses de talent; la
trompettiste Clora Bryant, par exemple, qui était aussi une
excellente chanteuse, confie à Linda Dahl : «Je me suis rendue compte que
je devais chanter – ils en veulent deux pour le prix d’une. Ils ne veulent pas
qu’on reste debout à juste jouer, sinon ils ne vous apprécieront pas. C’est une
des raisons pour lesquelles j’ai commencé à chanter, mais je me suis aussi
rendue compte que j’aimais ça, alors je le fais de plus en plus.» Active
sur la bouillonnante scène de Los Angeles dans les années 1940, Bryant va
s’affirmer comme la première femme trompettiste à adopter le bebop, sous
l’influence de Dizzy Gillespie, qui lui prodiguera souvent ses encouragements. En
Californie, elle croise Dexter Gordon, Wardell Gray, Sonny Criss, et plus tard,
à l’époque du Lighthouse sur la plage, Shorty Rogers, Max Roach et Clifford
Brown. Dans les années 1950, elle fait partie d’un sextette féminin dirigé par
la violoniste Ginger Smock; mais ce sera surtout grâce à des engagements à Las
Vegas, où elle croise deux de ses idoles, Harry James et Louis Armstrong, et
dans les chics clubs de New York et des Catskills que Bryant va véritablement
gagner sa vie. Suite à une crise cardiaque dans les années 1990, elle doit
abandonner la trompette, mais elle continuera à se produire comme chanteuse;
elle est décédée en 2019 à l’âge de 92 ans. Écoutons un extrait de son seul
album, Gal with a Horn, paru en 1957 :
Le portrait rapide que je viens de
faire de plusieurs instrumentistes-chanteuses ne doit pas faire penser que
l’essentiel du jazz joué par des femmes dans les années 1940, 50 et 60 l’était
dans les casinos de Las Vegas, les hôtels de montagne fréquentés par let jet
set et les clubs chics de Manhattan; certaines
instrumentistes de cette époque vont aussi se démarquer dans des
contextes moins luxueux, certaines atteignant même un statut équivalent à celui
de leurs collègues masculins. Il faut comprendre que la dominante masculine
implicite dans toute la sous-culture jazzistique, comme on l’a vu jusqu’ici, a
longtemps rendu les possibilités de percer presque impossibles pour les femmes.
Les qualités d’un jazzman (le terme lui-même est délibérément articulé comme
«homme-jazz») ont longtemps été assimilées à des traits dits «masculins» :
grande confiance en soi, agressivité, compétitivité, puissance dans le jeu; à
tel point que les musiciens démontrant des qualités plus «féminines» ont
souvent été ostracisés au sein de leur propre communauté (qu’on pense aux
difficultés de Lester Young, dont le jeu aérien se distinguait à ses débuts du
style alors dominant, vu comme plus «viril», issu de Coleman Hawkins). Il faut dire
aussi que la vie de musicien de jazz ne
correspondait pas vraiment à l’image que la société se faisait du rôle
traditionnel de la femme : longues absences du foyer, vicissitudes de la
vie de tournée (souvent dans des conditions qui exposaient les artistes au
racisme et à d’autres formes de violence), ainsi que de longues heures passées
dans des lieux souvent peu recommandables (qu’on pense aux clubs d’une certaine
époque, souvent gérés et fréquentés par la pègre); tout ceci sans même
mentionner la propension des musiciens à l’alcoolisme ou à la toxicomanie… La
compétition pour obtenir les meilleurs engagements s’inscrivait par ailleurs
dans ce machisme environnant, où un homme aurait difficilement accepté de se
voir surclassé par une femme jouant du même instrument. Ces attitudes vont
largement écarter les femmes instrumentistes de l’avant-scène, celles-ci
s’attirant même un certain mépris de la part de leurs collègues masculins –
combien de fois a-t-on entendu des jazzmen dire : «c’est pas mal pour une
femme»? Mais progressivement, les femmes instrumentistes vont se tailler leur
propre place dans cette culture, et le talent et la persévérance de certaines
finira par leur valoir le respect et les encouragements de certains collègues
masculins, voire de certains critiques, comme Leonard
Feather, par exemple, qui a eu plusieurs initiatives intéressantes pour
mettre de l’avant les femmes instrumentistes, notamment un disque de 1954 baptisé Cats vs. Chicks,
où le groupe de Clark Terry et celui de Terry Pollard traitaient les mêmes
thèmes en alternance. Voici un extrait de ce disque où on peut entendre le
groupe de Pollard, avec Beryl Booker au piano, Elaine Leighton à la batterie,
Norma Carson à la trompette, Mary Osborne à la guitare, Corky Hecht (ou Hale) à la harpe et Pollard au
vibraphone :
On peut inscrire ce disque dans un
mouvement qui vise à une meilleure reconnaissance et une meilleure visibilité
des instrumentistes féminines à cette époque; il faut dire que nombre de femmes
de grand talent vont émerger dans les années 1950, dont plusieurs n’avaient rien
à envier aux hommes de jazz contemporains.
C’est certainement le cas de la
tromboniste Melba Liston. Née à Kansas
City, elle déménage avec sa mère à Los Angeles à l’âge de 10 ans. Encore
adolescente, elle fait partie d’un orchestre accompagnant les numéros au
Lincoln Theatre; c’est là qu’elle commence à écrire des arrangements, d’abord
de manière plutôt autodidacte : «(le chef d’orchestre) m’a dit :
‘Sais-tu écrire?’ J’ai dit : ‘Oh, oui.’ Alors il a fallu que je retourne
voir mes professeurs pour qu’ils me montrent comment on organise un score et
tout.» Bientôt, elle rejoint l’orchestre de Gerald Wilson et réalise ses
premiers disques, notamment avec un ancien camarade de classe, Dexter Gordon, en 1947. Deux ans plus tard, c’est
Dizzy Gillespie qui l’appelle à New York pour jouer et composer pour son big
band; elle le retrouvera aussi plus tard dans les années 1950, lors des tournées
de Dizzy pour le Département d’État. En 1959 paraît sur Metrojazz Melba Liston and her ‘bones, où ses interlocuteurs
sont entre autres les trombonistes Al Grey, Jimmy Cleveland et Slide Hampton. À
la même époque, elle écrit des arrangements pour Randy Weston, notamment pour
ses albums Uhuru Afrika et Highlife, et elle tourne avec un
groupe féminin, notamment aux Bermudes. En 1960, on la retrouve au sein de
l’orchestre que Quincy Jones amène en Europe; on peut la voir ici en solo avec
cet orchestre, dans son propre arrangement de cette ballade de Larry Clinton
inspirée de Debussy, My Reverie :
Si
Melba Liston dirige parfois ses propres groupes dans les années 1960, elle est
surtout active comme musicienne de studio et arrangeuse. En 1973, elle
collabore de nouveau avec Randy Weston pour l’album Tanjah, mais
l’année suivante elle décide de se rendre en Jamaïque, où elle est directrice
du département afro-américain au sein de l’Institute of Music; elle écrit aussi
la musique d’un film jamaïcain, Smile Orange. Liston va rester à l’extérieur
des USA pendant presque toutes les années 1970; nous la retrouverons plus tard.
Camarade de classe de Melba Liston à
Los Angeles, la saxophoniste Elvira ‘Vi’ Redd était la fille du batteur de la Nouvelle-Orléans
Alton Redd. Comme Liston et Clora Bryant, Redd a surtout été active sur la Côte
Ouest; influencée par Charlie Parker, elle a une sonorité bluesy qui lui
permet de se glisser autant dans des contextes plus modernes (elle a collaboré
avec Max Roach, Roland Kirk et Dizzy Gillespie), que dans des situations où un
style plus classique est de mise, par exemple avec l’orchestre de Count Basie,
avec lequel elle s’est rendue jusqu’en Afrique en 1968. Fait rare pour une
instrumentiste féminine, elle a fait paraître deux albums sous son nom au début
des années 1960, d’abord Bird Call pour United Artists, puis Lady
Soul pour Atco. On l’aperçoit dans un extrait de l’émission de télévision Jazz
Scene USA en 1962, avec entre autres le trompettiste Carmell Jones; elle
joue une des pièces tirées de son album Bird Call, une composition de
Leonard Feather qui est aussi un hommage à une des principales inspirations de
Redd, I Remember Bird :
Beaucoup
connaissent sans doute Marian McPartland pour sa
remarquable émission Piano Jazz, où elle reçut pendant plus de 30 ans à
la radio publique des musiciens de jazz en entrevues et en musique; mais son
parcours est assez singulier : pianiste britannique (née Marian Turner),
elle s’engage dans l’USO (United Service Organisation) pendant la guerre pour
jouer de la musique pour les troupes. Au cours d’une jam session en Belgique,
elle rencontre le trompettiste américain Jimmy McPartland, qu’elle va épouser
et avec lequel elle gagne les USA en 1946. Sous le nom de scène de Marian Page, elle se produit surtout avec les groupes
de Jimmy et commence à composer. C’est au début des années 1950 que sa carrière
solo va prendre son envol, cette fois sous le nom de Marian McPartland :
elle se produit surtout en trio et est remarquée
par Leonard Feather et force l’admiration de plusieurs musiciens, notamment
Coleman Hawkins. Elle enregistre pour Savoy et débute un engagement à la
Hickory House, sur la 52e rue à New York, où elle sera régulièrement
en vedette jusqu’au début des années 1960; jusqu’en 1956, son batteur est Joe
Morello, qui rejoindra bientôt le fameux quartette de Dave Brubeck. Parmi ceux
qui viennent souvent l’entendre, on retrouve nul autre que Duke Ellington. Tout
au long des années 1950 et 60, elle écrit aussi pour le célèbre magazine de
jazz Down Beat.
Si McPartland
est moins active sur les scènes dans les années 1960, elle va se consacrer à
l’éducation et animer une émission de radio hebdomadaire; c’est à ce moment
qu’elle commence à réaliser des interviews avec différents musiciens, une
pratique qu’elle va continuer pour la radio publique américaine (NPR) à partir
de la fin des années 1970. Au début de la décennie 70, elle avait aussi fondé le
label Halcyon, sur lequel elle fait paraître ses
propres albums, mais aussi des disques de Earl Hines, Dave McKenna et Jimmy
Rowles; par la suite elle sera surtout associée au label Concord, qui publiera
aussi plusieurs disques transcrivant ses rencontres pour Piano Jazz. Divorcée
de Jimmy McPartland en 1967, elle en reste tout de même très proche, et les
deux vont souvent collaborer musicalement jusqu’à la mort de Jimmy en 1991.
Elle développe aussi une amitié avec le compositeur Alec
Wilder, à la musique de qui elle dédie un album en 1974. À la fin des
années 1970, Marian McPartland s’implique dans plusieurs évènements visant à
valoriser la présence des femmes dans le jazz, notamment le Women’s Jazz
Festival de Kansas City, en 1978, dont nous reparlerons plus loin. Dans les
années 1980 et 90, elle dédie plusieurs albums à de grands
compositeurs de l’histoire du jazz, dont Billy Strayhorn, Benny Carter,
Mary Lou Williams et Duke Ellington. En 1998, elle retrouve Joe Morello et le
contrebassiste Bill Crow, son ancien trio de l’époque de la Hickory House, pour
un engagement au Birdland. Pour son 85e anniversaire, NPR lui dédie une émission spéciale enregistrée à ce
même Birdland, où elle a pu retrouver nombre des invités qui étaient passés à
son émission au cours des 25 dernières années, notamment Phil Woods, Jim Hall,
Billy Taylor, Ravi Coltrane et Barbara Carroll. Son dernier album, Twilight
World, est paru en 2008; en 2011, elle passe la main de son émission au
pianiste Jon Weber. Marian McPartland est décédée en 2013 à l’âge de 95 ans.
Voici cette grande dame du piano en 1975, interprétant sa composition Afterglow :
Contemporaine de McPartland, la
guitariste Mary Osborne s’illustre dans l’après-guerre comme une des
meilleures guitaristes modernes. Née dans le Dakota du Nord, Osborne est
marquée par la rencontre de Charlie Christian, qu’elle entend dans son
adolescence et qui va lui prodiguer ses encouragements tout en l’initiant au
style qu’il a développé, style adapté à cet instrument qui est alors encore
relativement nouveau, la guitare électrique. Rejoignant New York avec
l’orchestre de Buddy Rogers en 1940, Mary Osborne y deviendra vite une habituée
des clubs de la 52e rue. En 1945, lors d’un concert à Philadelphie
qui met aussi en vedette Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Coleman Hawkins et
Art Tatum, c’est pourtant elle qui est remarquée par la critique et le public!
Un peu plus tard la même année, elle assure l’introduction d’un concert
all-star organisé à la Nouvelle-Orléans par le magazine Esquire, où on entend
aussi Louis Armstrong. Bientôt, elle enregistre avec Mary
Lou Williams (au sein de ses Girl Stars), avec Coleman Hawkins, et avec son
propre trio. Mais, dit-elle, ses propres disques n'étaient pas à proprement
parler des disques de jazz : «j’aime bien la façon dont Bucky Pizzarelli
décrit le genre de chose que nous faisions alors – déguiser du jazz en musique
d’hôtel (c.à.d.
lounge, c'est moi qui souligne). Et c’était à peu près ça. […] On a enregistré
d’abord pour Signature Records, puis Decca et leur sous-label, Coral. Pour Decca c’était essentiellement commercial. On avait des
chansons et un petit groupe comme celui de Nat (King) Cole; le mien était dans
la même veine que le sien […]». Osborne jouira d’une bonne visibilité également
à la radio, avec le quartette du pianiste Elliot Lawrence, pour l’émission du
matin à CBS, pendant plus de 10 ans. En 1960 paraît un album sous son nom, A Girl and her Guitar. À la fin des années 1960,
elle déménage en Californie où elle fonde avec son mari, le trompettiste Ralph
Scaffidi, la Osborne Guitar Company. Toujours active dans les années 1970, elle
enseigne et apparaît dans divers festivals; elle grave un nouvel album pour l’étiquette Stash au début des
années 1980. Un an avant sa mort de la leucémie (en 1992) elle s’était produite
au Village Vanguard. Écoutons et regardons cette guitariste exceptionnelle dans
deux extraits de l’émission de Art Ford, Jazz Party, à la fin des années 1950 :
(Dans le premier extrait on aura remarqué celle qui, assise à côté de Mary Osborne, paraissait goûter son solo, Billie Holiday elle-même!).
-------
Nous avons entendu plus tôt la
vibraphoniste Terry Pollard; originaire
de Detroit, Pollard était en fait principalement une pianiste, d’abord active
sur la scène locale. Repérée par le vibraphoniste Terry Gibbs, elle fait partie
du groupe de ce dernier tout au long des années 1950, et elle réalise un unique disque sous son nom pour Bethlehem en 1955. On
la retrouve sur disque par la suite avec Yusef Lateef et Dorothy Ashby (qui
étaient alors encore des musiciens locaux), mais, marquée par le racisme, elle
restera principalement basée à Detroit et ne se produira plus que de façon
irrégulière, le plus souvent avec son propre trio dans un club baptisé le Hobby
Bar; elle accompagnera même les Supremes à l’occasion. Souffrant d’un anévrisme
et d’un AVC en 1978, elle restera partiellement paralysée, mais elle continuera
de pratiquer avec sa seule main droite. Elle est décédée en 2009.
Une autre pianiste qui a eu une courte
carrière, Lorraine Geller a quand même un
petit legs discographique. Née Lorraine Walsh dans l’Oregon, elle débute dans
un combo dirigé par l’ancienne vedette des Sweethearts of Rhythm, Anna Mae
Winburn. En 1951, elle épouse le saxophoniste Herb Geller, et les deux
deviennent des musiciens très actifs sur la scène californienne, réalisant quelques
sessions en quartette et en sextette pour EmArcy. On entend également la
pianiste auprès de Maynard Ferguson, dans le quartette du contrebassiste Red
Mitchell, et comme accompagnatrice de la chanteuse Kay Starr. Décédée
subitement en 1958, Lorraine
Geller laisse également un unique disque en trio pour l’étiquette Dot, Lorraine
Geller at the Piano, enregistré en 1954 mais paru de manière posthume; écoutons
en un extrait, une des compositions de la pianiste baptisée Mystery
Theatre :
Parmi les autres pianistes actives
dans les années 1950 et 60, mentionnons d’abord Pat
Moran, qu’on aurait pu inclure dans la liste des
pianistes-chanteuses un peu plus tôt, mais qu’on connaît probablement plutôt
aujourd’hui pour son album This is Pat Moran, de 1958, où on pouvait
entendre le grand contrebassiste Scott LaFaro peu avant qu’il ne rejoigne le
trio de Bill Evans. Remarquée par Nat King Cole et Miles Davis, influencée par
Bud Powell, Moran accompagne aussi une de ses bonnes amies, la chanteuse
Beverly Kelly. Fixée sur la Côte Ouest, elle fait partie du big band de Terry
Gibbs. Si elle semble avoir abandonné le jazz, dans une entrevue de 2020 elle
raconte que lorsque Miles Davis est passé la voir au Birdland, il aurait dit "that
bitch can play!"; «c’est probablement le meilleur compliment qu’on m’ait jamais
fait!» affirme-t-elle alors. Pour sa part, Patti Bown était déjà
une amie d’enfance de Quincy Jones; elle fera plus tard partie de l’orchestre
que celui-ci amène en Europe pour la revue Free and Easy. Elle était
aussi une des accompagnatrices préférées de Gene Ammons, apparaissant sur
plusieurs de ses albums; elle a aussi laissé un très bon disque sous son nom
pour Columbia, Patti Bown Plays Big Piano. Aveugle dès l’âge de 6 ans, Valerie Capers avait
écrit plusieurs pièces pour l’orchestre de Mongo Santamaria, au sein duquel son
frère Bobby était saxophoniste. Si le frère et la sœur réalisèrent aussi un
45-tours soul pour Atlantic, l’album de Valerie pour le même label, Portrait in Soul, de 1966, est bel et bien un album de jazz où on entend entre
autres le saxophoniste Robin Kenyatta. Si la carrière de Bertha Hope a été plutôt tardive, elle avait déjà baigné
dans le jazz depuis sa jeunesse : déjà amie de Eric Dolphy dans son
adolescence, elle est influencée par Bud Powell, dont le frère Richie lui prodigue
des cours informels. Elle s’intéresse aussi à la musique de Thelonious Monk, et
épouse bientôt un autre pianiste au style très moderne, Elmo Hope; on l’entend
sur quelques duos avec lui sur le disque Hope-Full, enregistré et paru
en 1961. Après la mort de Elmo en 1967, elle forme un groupe pour jouer ses
compositions avec le contrebassiste Walter Booker, qui deviendra son compagnon.
Si elle ne sera pas active musicalement durant la majorité des années 1970,
elle en profite pour parfaire son éducation musicale et revient au jazz au
début des années 1980, s’intéressant entre autres à la musique de Ornette
Coleman. Elle réalise ses premiers albums sous
son nom dans les années 1990, mettant souvent à son répertoire des compositions
de Elmo Hope. Elle fait aussi partie du groupe féminin Jazzberry Jam, avec les vétéranes
Carline Ray et Paula Hampton, entre autres. Si Jane
Getz a surtout été une musicienne de studio très prolifique dans les
années 1970 - réalisant même quelques albums de musique pop, entre autres sous
le pseudonyme de Mother Hen - elle avait pourtant débuté dans des groupes de
jazz sans concession, ceux de Charles Mingus et Pharoah Sanders, avec lesquels
elle a enregistré. Revenue au jazz dans les années 1990 avec un album baptisé
ironiquement No Relation (un clin d’œil à Stan Getz, avec qui elle n'avait donc aucun lien de parenté...), elle a notamment
collaboré avec le vibraphoniste Dave Pike.
Si les combos avec orgue, dont la
popularité va exploser au début des années 1960, seront souvent prétextes à une
forme de jazz perçue comme assez virile, on va retrouver, au milieu des Brother
Jack McDuff, Johnny Hammond Smith, Richard Groove Holmes et autres Baby Face
Willette, une figure féminine assez importante, Shirley
Scott, qu’on avait surnommée Queen of the Organ. Rendue
célèbre par sa collaboration avec le saxophoniste Eddie ‘Lockjaw’ Davis dès la
fin des années 1950, elle va également réaliser un nombre impressionnant de
disques sous son nom, d’abord pour Prestige, puis pour Impulse, souvent avec
son mari, le saxophoniste Stanley Turrentine. Dans les
années 1970, elle tourne et enregistre avec un autre saxophoniste,
Harold Vick; les voici par exemple jouant une composition de Vick, Don’t
Look Back :
Après un certain déclin des groupes
avec orgue dans les années 1970 et 80, Shirley Scott va connaître un certain
regain d’activité dans les années 1990; elle est décédée en 2002. Parmi les
autres organistes féminines, mentionnons Trudy Pitts,
qui a aussi enregistré pour Prestige; Rhoda Scott,
dont la carrière s’est surtout déroulée en France; et Gloria Coleman, qui avait d’abord été
contrebassiste et dont l’album de 1964 pour Impulse, Soul Sisters,
mettait aussi en vedette la batteuse Pola Roberts.
Pendant cette période où le combo avec
orgue règne, la saxophoniste Willene Barton va
développer une amitié avec celui qui avait un peu lancé la carrière de Shirley
Scott, Eddie ‘Lockjaw’ Davis, qui sera même un temps l’agent de Barton. Saxophoniste
au jeu vigoureux dans la lignée de Elsie Smith, celle-ci avait été marquée dans
son adolescence par une apparition des Sweethearts of Rhythm à l’Apollo de
Harlem; dans le portrait qu’en fait Linda Dahl, Barton souligne le choc qu’elle
a reçu devant le spectacle presque inattendu d’un orchestre de femmes :
«j’étais en totale admiration. J’ai pensé : ‘Oh, ça alors, ces filles
peuvent faire ça – alors moi aussi.’ » Au début des années 1950, elle rejoint
un orchestre dirigé par l’ancienne directrice des Sweethearts, Anna Mae
Winburn; plus tard elle co-dirigera des groupes avec une autre ancienne des
Sweethearts, la saxophoniste Myrtle Young, puis avec Elsie Smith. Si elle a
surtout acquis un public au niveau local, elle a connu une certaine renaissance
dans les années 1980. Écoutons un extrait de son seul album, There She Blows,
également édité sous le titre The Feminine Sax, avec l’organiste Dayton
Selby :
Parmi les musiciennes qui vont émerger
dans les années 1950 et 60, toutes ne seront pas originaires des USA; en
Allemagne, par exemple, sur la scène de Francfort, on retrouve la pianiste Jutta Hipp. Membre du groupe du saxophoniste Hans
Koller, elle dirige son propre quintette à partir de 1953, avec les
saxophonistes Emil Mangelsdorff et Joki Freund. C’est grâce à Leonard Feather,
qui l’entend à cette époque, qu’elle fait paraître un
disque pour Blue Note en 1954; elle émigre bientôt à New York, où Feather
l’aide à trouver un engagement à la Hickory House. Elle apparaît au festival de
Newport en 1956, et réalise trois autres albums pour
Blue Note, dont un avec Zoot Sims. Mais sa carrière va prendre fin de manière
abrupte; dans les années 1960 on la retrouve dans une fabrique de vêtements, et
elle abandonne progressivement la musique. Elle va se consacrer à la peinture
et au dessin, mais souffre de dépression et se coupe de la plupart de ses
contacts dans le monde du jazz. Elle est décédée en 2003. En 2015, l’étiquette BE Jazz a produit un coffret de 6
CD plus 1 DVD dédié à sa musique et à son œuvre plastique.
Une pianiste qui aura une carrière
plus féconde, Toshiko Akiyoshi est venue au jazz dans l’atmosphère très américaine régnant
au Japon après la guerre. Elle assimile vite les sons du jazz moderne, et fonde
au début des années 1950 le Cozy Quartet, avec le saxophoniste Sadao Watanabe. Remarquée
par Oscar Peterson lors d’une tournée de ce dernier au Japon, elle enregistre sur place une session pour le producteur Norman
Granz, avec les musiciens de Peterson. Elle part étudier aux USA, à la
prestigieuse Berklee School of Music, en 1956; performant à cette époque en kimono
traditionnel, elle cause une certaine sensation et est souvent invitée au
festival de Newport. Rencontrant le saxophoniste Charlie Mariano, elle l’épouse
en 1959; les deux vont co-diriger un quartette,
puis faire plusieurs séjours au Japon dans les années 1960. Voici un rare
extrait de Akiyoshi à cette époque, en solo, filmée par l’INA en France en
1965 :
Après avoir divorcé de Mariano en
1967, Toshiko Akiyoshi épouse le saxophoniste et
flûtiste Lew Tabackin en 1969; installés en Californie, les deux fondent en
1973 le Toshiko Akiyoshi-Lew Tabackin Big Band, qui deviendra vite l’un des
orchestres de jazz les plus créatifs de son époque, et le véhicule principal pour
les compositions de la pianiste. Utilisant des éléments tirés de la musique et
des traditions japonaises dans un contexte très moderne, Akiyoshi se révèle comme une compositrice unique et
une cheffe d’orchestre de grand talent, servie par des musiciens de premier
ordre, dont les saxophonistes Bill Perkins et Gary Foster et le tromboniste
Britt Woodman, un ancien de chez Duke Ellington. Akiyoshi et Tabackin fondent
leur propre label, Ascent Records, en 1980, et déplacent leurs activités à New
York en 1982. L’orchestre prend bientôt le nom de Toshiko Akiyoshi Orchestra,
avec un personnel plus newyorkais cette fois, dont Frank Wess, Brian Lynch,
Conrad Herwig et Jim Snidero; l’orchestre existe jusqu’en 2003, réalisant en 2001
une des œuvres maîtresses de Akiyoshi, la suite Hiroshima
– Rising from the Abyss. Toshiko Akiyoshi a 92 ans aujourd’hui; je crois
qu’elle est toujours active.
Si Jutta Hipp et Toshiko Akiyoshi ont
atteint une certaine notoriété en venant aux USA, il y a d’autres musiciennes
dont le talent a surtout fleuri sur des scènes locales ou nationales; c’est le
cas par exemple des saxophonistes Britanniques Kathleen
(ou Kathy) Stobart et Barbara
Thompson. Stobart avait d’abord joué avec l’orchestre de Vic Lewis avant de
former son propre groupe au début des années 1950; mais elle est surtout connue
pour ses collaborations avec le trompettiste Humphrey Lyttelton, d’abord à la
fin des années 1950, puis au début des années 1970 et de nouveau dans les
années 1990. À la fin des années 1970, elle
forme un quintette avec notamment le trompettiste Harry Beckett. Si Stobart a
surtout œuvré sur la scène britannique, elle est apparue au festival de Nice avec
son propre groupe, et à New York avec Zoot Sims. En 1982, elle est la tête d’affiche
du premier festival de jazz consacré aux femmes en Angleterre. Prenant sa
retraite de la scène en 2007, Kathy Stobart est décédée en 2014, à l’âge de 89
ans.
Barbara Thompson
appartient
à une plus jeune génération de musiciens anglais nés pendant la guerre et qui
marqueront la scène à partir de la fin des années 1960. Mariée au batteur du
groupe progressif et jazz-rock Colosseum, Jon Hiseman, Thompson apparaît sur
certains albums de cette formation au début des années 1970. Membre de
l’orchestre du compositeur Neil Ardley, elle participe à sa trilogie formée par
les albums A Symphony of Amaranths, Kaleidoscope of Rainbows et Harmony
of the Spheres. À la fin des années 1970, elle fait partie des membres
fondateurs de l’United Jazz+Rock Ensemble avec les Allemands Wolfgang Dauner et
Volker Kriegel; elle dirige aussi ses propres groupes, dont Paraphernalia, groupe
jazz-rock toujours actif. Après un diagnostic de la maladie de Parkinson en
1997, Thompson réduit son activité. En 2020 sont parus un nouvel album de
Paraphernalia, Bulletproof, où le groupe, sans Thompson, joue sa musique
avec le National Youth Jazz Orchestra; la même année est
parue une anthologie de 14 disques compacts consacrée à ses enregistrements
pour la BBC.
D’origine néo-zélandaise, la pianiste Judy Bailey est
active à Sydney en Australie depuis le début des années 1960. Elle apparaît sur
des disques des saxophonistes Errol Buddle et Don Burrows avant de diriger ses
propres sessions pour CBS. Enseignante au conservatoire de musique de Sydney,
elle a aussi dirigé le Sydney Youth Jazz Ensemble; dédiée à l’enseignement,
elle a aussi travaillé à des programmes pour rejoindre les jeunes enfants. Son
album fusion de 1976, Colours, est aujourd’hui très recherché par les
collectionneurs. Récipiendaire de nombreux prix, elle a mené une tournée avec
son quartette en Asie du Sud-Est; on l’a aussi entendue en concert à l’opéra de
Sydney.
Dans son livre, Linda Dahl cite une
étude réalisée par deux musicologues en 1978, étude ayant trait au lien que
font les gens, musiciens comme non musiciens, entre différents instruments et le genre. Si cette étude en dit
peut-être plus long sur les diverses perceptions et biais cognitifs qui nous
sont inculqués par la société, il reste que ce qu’elle nous communique reflète
une influence assez profonde qui, peut-être encore inconsciemment aujourd’hui,
conditionne ce que bien des gens perçoivent comme des instruments «masculins»
et «féminins». Ainsi, parmi les participants à cette étude, on a classé la
flûte, le violon et la clarinette comme des instruments spécifiquement
féminins. Il reste à voir si les résultats de cette étude s’appliquent au monde
du jazz; en effet, on retrouve assez peu de femmes clarinettistes ayant marqué
l’histoire du jazz (Dahl cite le nom de Anne DuPont,
une clarinettiste qui avait dirigé son propre orchestre Swing à la fin des années
1930). Du côté des flûtistes, on peut citer Bobbi
Humphrey, qui a réalisé six albums pour Blue Note au début des
années 1970. Née au Texas, Humphrey reçoit les encouragements de Dizzy
Gillespie dans sa jeunesse; elle rejoint New York en 1971 où elle se produit en
amatrice à l’Apollo, puis apparaît auprès de Herbie Mann et au Tonight Show.
Elle joue sur ce qui sera le dernier album de Lee Morgan et signe son premier
album, Flute-In, la même année. À partir de son troisième album, Blacks
and Blues, produit par les frères Mizell, elle prend un virage plus funk, suivant
l’exemple de Donald Byrd; quittant Blue Note pour Epic en 1977, elle s’éloigne
définitivement du jazz. On a aussi entendu Humphrey avec Stevie Wonder. Pour
les violonistes, on mentionnera surtout Emma ‘Ginger’
Smock, active sur la scène de Los Angeles dès les années 1940. De formation
d’abord classique, Smock découvre le jazz en écoutant les violonistes Joe
Venuti, Stuff Smith et Eddie South. En 1943, elle forme deux trios féminins,
les Sepia Tones et les Three V’s (qui deviendra plus tard un quartette, donc les Four V's). Active dans les cabarets, elle apparait aussi
à la télévision, dirigeant son orchestre dans une émission baptisée The
Chicks and the Fiddle, au début des années 1950. Dans les années 1960, on l’a
retrouvée sur un bateau de croisière avec son groupe, The Shipmates and
Ginger. Musicienne de studio dans les années 1970, elle gagne surtout sa
vie accompagnant des vedettes de Las Vegas, comme Sammy Davis Jr. et Johnny
Mathis. Ginger Smock est décédée en 1995; dix ans plus tard, grâce à l’historien
du violon jazz Anthony Barnett, un CD de ses enregistrements inédits est paru,
intitulé Strange Blues. Écoutons Ginger Smock au sein du groupe de
Vivien Garry dans une pièce au titre délicieux, A Woman’s Place is in the
Groove :
-------
Un instrument qui est également perçu
comme plutôt féminin, la harpe a effectivement donné au jazz quelques
musiciennes intéressantes; dans les années 1930 déjà, Adele Girard avait participé
à un groupe baptisé The Three T’s, avec les frères Jack et Charlie Teagarden et
l’ancien comparse de Bix Beiderbecke, Frankie Trumbauer. La harpiste allait
épouser le clarinettiste Joe Marsala en 1937, et on l’a entendue au sein de ses
groupes pendant de longues périodes; les deux ont notamment dirigé l’orchestre
maison à la Hickory House à New York pendant une dizaine d’années. Surtout
active dans les années 1950, Betty Glamann
avait collaboré avec Marian McPartland, co-dirigé un quintette avec le
contrebassiste Rufus Smith, et enregistré avec Duke Ellington, Kenny Dorham,
Oscar Pettiford, le Modern Jazz Quartet et Michel Legrand (c’est elle par
exemple qu’on entend avec Miles Davis sur la pièce Django); elle laisse
aussi un album pour Mercury, Swingin’ on a Harp. On peut aussi
mentionner Corky Hale, qu’un album de
1956 nous fait entendre accompagnée par le quintette de Chico Hamilton (on la retrouvait déjà sur le disque Cats vs. Chicks, sous le nom de Corky Hecht).
Mais la plus célèbre des harpistes de
jazz est certainement Dorothy Ashby. Née Dorothy
Jeanne Thompson à Detroit, elle débute au piano mais adopte définitivement la
harpe vers l’âge de 20 ans. Elle tourne avec son propre trio, qui inclut son
mari, le batteur John Ashby. Ses premiers albums (pour Regent et Prestige) la
jumellent au flûtiste Frank Wess. Surtout active dans sa ville natale, Ashby
anime une émission de jazz à la radio, gagne un référendum de Down Beat en
1962, et collabore avec son mari à une troupe de théâtre pour laquelle elle
écrit et interprète les trames sonores, les Ashby Players. En 1968, Dorothy Ashby réalise pour Cadet à Chicago
l’album iconique Afro-Harping, arrangé par Richard Evans, tout comme le
seront ses deux suivants pour le label, Dorothy’s Harp et The
Rubaiyat of Dorothy Ashby, ce dernier fascinant mélange auquel elle intègre
les sonorités du koto et du kalimba, ainsi que des voix récitant ou psalmodiant
des extraits poétiques ou spirituels. De cette époque, écoutons un extrait de Afro-Harping:
Réinstallée en Californie à la fin des années 1960, Ashby sera très active dans les studios dans les années 1970 et 1980, apparaissant sur des albums de Bill Withers, Stevie Wonder, Earth Wind & Fire ou Bobby Womack. Ses deux derniers albums paraîtront sur Philips au Japon dans les années 1980. Dorothy Ashby est morte d’un cancer en 1986; elle avait 53 ans.
Les nouvelles
formes de jazz qui apparaissent dans les années 1960 correspondent, on
le sait, à un moment politique particulier. Si le féminisme n’est peut-être pas
au centre des préoccupations des premiers acteurs du free jazz, il deviendra
rapidement évident que la présence de mouvements de libération de la femme et
des questions féministes en général dans l’actualité va amener certains musiciens
et musiciennes à se questionner sur la place des femmes au sein du microcosme jazzistique.
Une des premières actrices à faire entendre sa voix au sein de l’avant-garde
sera cependant une iconoclaste plutôt inclassable, et sa musique atteindra d’abord
le public à travers le travail d’instrumentistes masculins…
Carla Borg (plus tard Carla Bley) est née en Californie dans une famille
religieuse qui encourage son apprentissage du piano et du chant; mais,
cherchant à échapper à l’influence familiale très stricte, elle se rend à New
York à 17 ans, attirée par le jazz. Elle devient cigarette girl au
célèbre Birdland, où elle rencontre un pianiste canadien qui vient lui aussi
d’arriver dans la Big Apple, Paul Bley, qu’elle
épouse en 1957. Dans une entrevue typiquement loufoque avec Linda Dahl,
Carla Bley évoque les premières années du couple en Californie, où Paul côtoie
quelques jeunes avant-gardistes qui ont nom Ornette Coleman et Don Cherry. «Je
ne savais pas que j’étais témoin de quoique ce soit quand j’étais là-bas à Los
Angeles; je faisais juste regarder à travers une fissure dans un mur…
j’écoutais, complètement. Comme une énorme oreille, avec rien s’y rattachant.» Si
sa perception de la manière dont Paul Bley l’a encouragée à commencer à écrire n’est
pas exactement flatteuse (elle raconte : « il arrivait en me
disant : «eh bien, j’ai une session demain et j’ai besoin de six bonnes
pièces!», alors je m’assoyais et j’en écrivais six»), il n’en reste pas moins
que c’est bien grâce à lui si on retrouve des pièces de Carla Bley sur disque à
partir du début des années 1960, notamment sur des albums du trio de Jimmy
Giuffre, puis sur ceux de Paul Bley lui-même. (Remarquons ici que celle qui
sera également la compagne de Paul Bley, Annette Peacock, a aussi contribué
plusieurs compositions au répertoire du pianiste! – À ce propos, un journaliste
qui lui faisait remarquer que sa propre femme était incapable d’écrire une note
de musique, Carla aurait déclaré : «pourquoi vous ne la prêtez pas à Paul
Bley pour un mois?». Le sarcasme de Carla mis à part, on connaît bien sûr
l’importance qu’a eue Annette Peacock pour la musique d’avant-garde depuis les
années 1960).
En 1964, les Bley, qui
divorcent bientôt, sont parmi les membres fondateurs de la Jazz Composer’s
Guild et du Jazz Composer’s Orchestra, rassemblant nombre d’avant-gardistes en
vue de la scène newyorkaise, dont Bill Dixon, Steve Lacy, Archie Shepp et
Milford Graves; parmi les organisateurs principaux du JCOA on retrouve le
trompettiste Michael Mantler, qui devient bientôt le compagnon de Carla Bley. À
la fin des années 1960, Carla Bley écrit pour Gary Burton (qui avait déjà
enregistré de ses pièces avec son quartette) le disque A Genuine Tong Funeral; elle collabore aussi avec Charlie Haden pour son Liberation Music Orchestra, tout en élaborant, avec le
poète Paul Haines et une impressionnante cohorte de musiciens et chanteurs/chanteuses,
dont les membres du JCO, la gigantesque «chronotransduction» ou opéra-jazz Escalator Over the Hill, dont la réalisation s’étend sur presque 4 ans. Ces trois
œuvres représentent sans doute sa période créative la plus intense, et pointe
déjà vers le mélange de styles, formes et registres qui caractériseront le
reste de son œuvre. Influencée par Kurt Weill, les minstrel shows, Duke
Ellington, les numéros du music-hall anglais, le tango, le blues et le rock,
Carla Bley infuse ces éléments apparemment disparates d’une bonne dose d’humour
pas toujours subtil hérité du slapstick.
En 1972, Bley
et Mantler fondent une compagnie de distribution, le New Music
Distribution Service, consacrée à la musique créative, puis en 1974 le label
WATT pour la publication de leurs propres albums, toujours distribués par ECM
de nos jours. C’est à la fin des années 1970 que Carla Bley enregistre ses
albums les plus caractéristiques, Dinner Music, European Tour 1977,
Musique Mécanique et Social Studies; on reconnaîtra bien le style
de ses ensembles de l’époque dans cet extrait d’un concert italien de 1978:
C’est peut-être curieux d’avoir choisi une pièce où Carla Bley ne joue pas vraiment, mais c’est surtout pour illustrer son travail de compositrice, d’ailleurs elle se décrivait elle-même comme «99% compositrice et 1% pianiste».
Divorcée de Michael Mantler en 1991,
son compagnon de vie depuis cette époque est le bassiste Steve Swallow, avec lequel elle collabore toujours. Après
une période où elle a écrit pour des orchestres de plus grande taille (sur Fleur
Carnivore et The Very Big Carla Bley Band par exemple, mais aussi
pour les différents avatars du Liberation Music
Orchestra de Charlie Haden), elle a souvent privilégié des contextes plus
intimes depuis le milieu des années 1990 (un de ses disques s’appelle
d’ailleurs Fancy Chamber Music). À 85 ans,
elle est toujours active, et ses compositions sont régulièrement couvertes par
des artistes de toutes générations.
-------
L’exemple de Carla Bley, qui a eu
trois longues et productives relations musicales avec ses compagnons de vie,
semble illustrer une tendance chez plusieurs musiciennes issues de
l’avant-garde des années 1960 et 70. D’une position ou elles ont souvent eu besoin
d’un mentor, d’un soutien masculin (critique, collègue ou partenaire) pour
faire leur place au sein de la communauté du jazz, les jazzwomen vont lentement
acquérir une plus grande égalité, une relation de collaboration plutôt que de
compétition.
La question de la communion
spirituelle va également se poser pour certaines, question centrale quand on
pense à l’univers musical de quelqu’un comme Alice
Coltrane. Née Alice McLeod à Detroit, elle apprend le piano et
l’orgue et accompagne bientôt les chœurs de son église locale; elle performe aussi
dans les clubs, d’abord du gospel et du R&B, puis du jazz. Mariée d’abord
au chanteur bop Kenny ‘Pancho’ Hagood, elle s’installe
à Paris en 1959, où elle sera un peu la protégée de Bud Powell, dont elle adopte le style volatile. Elle donne naissance à une fille en 1960, mais
Hagood ayant développé une importante addiction à l’héroïne, Alice quitte Paris
avec elle pour rentrer à Detroit. Elle reprend ses activités sur la scène
locale, avec son propre trio ou parfois avec Terry Pollard. On peut imaginer
que c’est cette dernière qui recommande Alice à Terry Gibbs, avec qui elle
avait longtemps joué dans les années 1950, et la pianiste se retrouve bientôt
sur la route avec le vibraphoniste, en 1962-63. C’est lors d’un engagement avec
Gibbs au Birdland qu’elle rencontre John Coltrane. Mariés en 1965, les Coltrane vont aussi développer une relation
spirituelle et musicale, puisque Alice remplace McCoy Tyner au sein du groupe
de John en janvier 1966. À cette époque, faisant fi des puristes, John Coltrane
adopte une esthétique proche de celle de ses cadets, les hérauts du free jazz
comme Archie Shepp et Albert Ayler, approche à laquelle Alice n’est
certainement pas étrangère puisque des œuvres comme A Love Supreme, Ascension
et Meditations sont ultérieures au début de sa relation avec John. Comme
pianiste, elle adopte certes un style moins virtuose que celui de McCoy Tyner,
peut-être plus proche du gospel de ses premières années : créant des
nappes sonores qui se rapprocheraient des drones de la musique indienne, elle
bâtit ses solos comme autant de volutes, de cascades de notes qu’on va
évidemment retrouver au cœur de son jeu à la harpe,
un instrument qu’elle adopte sur son premier album solo, A Monastic Trio,
enregistré en 1968 et paru à la fin de l’année, un peu plus d’un an après la
mort de John Coltrane.
La disparition de celui qu’elle
baptise bientôt Ohnedaruth (ce qui voudrait dire «compassion») va amener Alice
à se dédier à continuer ce qu'elle considère comme une quête spirituelle et musicale, tout d’abord en
continuant d’éditer des albums posthumes de John, à commencer par Expression,
qui sera suivi par Cosmic Music, puis le controversé Infinity, où
Alice ajoute des arrangements de cordes à des enregistrements du quartette de
John. Elle va aussi poursuivre avec ses propres
groupes l’esthétique des dernières formations de John, faisant souvent
appel à certains de ses collaborateurs des dernières années, Pharoah Sanders,
Jimmy Garrison et Rashied Ali. Ses albums pour Impulse, qu’on considère
aujourd’hui comme des classiques du jazz spirituel, sont à l’origine boudés par
la critique, qui ne saisit pas vraiment les subtilités d’une musique qui
tempère les excès du free jazz par une sensibilité peut-être plus féminine,
comme le mentionne un de ses musiciens de l’époque, le contrebassiste Cecil
McBee. Seul peut-être le le superbe Journey in Satchidananda, qui reste peut-être son œuvre la plus universellement
appréciée des jazzophiles, échappe alors à cette indifférence. Dans les années
1970, on l’entend aussi sur des projets d’autres musiciens, notamment Roland
Kirk, McCoy Tyner, Joe Henderson, Charlie Haden et même Carlos Santana, lui
aussi disciple de l’hindouisme.
C’est d’ailleurs à la vie spirituelle
que Alice Coltrane, qui prend le nom de Turiyasangitananda (raccourci en
Turiya) et adopte la robe orange des Swami ou
Samnyasin, va se consacrer à partir de la fin des années 1970; cette transition
est illustrée par ses albums pour Warner Bros., qui s’éloignent de plus en plus
des formes du jazz et de l’improvisation pour se rapprocher des formes
dévotionnelles. Dédiée à la vie au sein de l’ashram qu’elle a fondé en 1975, le
Vedantic Center en Californie, elle ne réalisera pas d’enregistrement
commercial jusqu’à son dernier album pour
Impulse en 2004, Translinear Light, où elle est rejointe par les deux
fils saxophonistes qu’elle a eus avec John, Ravi et Oran Coltrane. Alice
Coltrane est morte en 2007, à l’âge de 69 ans; en 2017, paraissait une
anthologie de sa musique dévotionnelle sur Luaka Bop, The Ecstatic Music of Alice
Coltrane, suivie en 2021 de Kirtan : Turiya Sings pour Impulse.
Voici deux extraits d’un documentaire de 1970 où on voit Alice Coltrane à la
harpe, puis avec un groupe où on retrouve Pharoah Sanders et Rashied Ali:
Si la position de Alice Coltrane est
assez exceptionnelle, nous devons aussi mentionner quelques musiciennes qui ont
eu une certaine visibilité au sein de l’avant-garde jazzistique des années 1960
et 70, souvent en tandem avec leurs partenaires de vie. Pensons par exemple à
la trompettiste Barbara Donald, qu’on a
d’abord découverte sur les deux disques réalisés par son compagnon, le
saxophoniste Sonny Simmons, pour le légendaire label d’avant-garde ESP-Disk’
dans les années 1960. Les deux seront surtout actifs par la suite sur la Côte
Ouest, au sein d’une petite communauté de musiciens de free jazz qui comprenait
aussi le saxophoniste Bert Wilson et les batteurs Smiley Winters et James
Zitro. Installée dans l’état de Washington, Donald divorce de Simmons en 1980
(elle apparaîtra quand même sur un de ses enregistrements dans les années
1990). Elle fonde son propre groupe, Unity, avec
notamment le saxophoniste Carter Jefferson, la pianiste Peggy Stern, et parfois
son propre fils, le batteur Zarak Simmons; le groupe réalise deux disques pour
Cadence Jazz Records au début des années 1980. À la suite d’une série d’AVCs
qui vont l’incapaciter, Barbara Donald doit abandonner la musique et être
placée dans un établissement de vie assistée à la fin des années 1990; elle est
décédée en 2013. Compagne du saxophoniste Jimmy Lyons, la bassoniste Karen Borca avait
suivi les cours de Cecil Taylor à la University of Wisconsin au début des
années 1970; jouant ensuite dans différents ensembles du pianiste, elle sera
également son assistante au Antioch College, puis celle du saxophoniste de
Taylor, Lyons lui-même, au Bennington College en 1974-75. Membre des groupes de
Lyons jusqu’à sa mort en 1986, elle est restée une musicienne
incontournable sur la scène des musiques improvisées à New York,
notamment avec Alan Silva, William Parker, Bill Dixon, et bien sûr ses propres
groupes, qu’elle a amenés dans de grands festivals européens (Allemagne,
Suisse, Finlande) ainsi qu’au Vision Festival à New York. Improvisatrice et
multi-instrumentiste ouverte aux musiques non-occidentales, Zusaan Kali Fasteau avait formé avec son
compagnon, le contrebassiste, clarinettiste et lui aussi multi-instrumentiste
Donald Rafael Garrett, le Sea Ensemble, réalisant trois albums dans les années
1970. Après leur séparation, Fasteau passe plusieurs années en Inde et au Népal
pour y étudier certaines techniques instrumentales et vocales. De retour à New
York, elle fonde son propre label, Flying Note, et enseigne l’introduction aux
musiques du monde. Mêlant les techniques
d’improvisation issues du jazz aux traditions de plusieurs pays dans une
synthèse originale, Fasteau utilisait plus d’une quinzaine d’instruments, dont
le saxophone soprano, le piano, le violoncelle, le sanza, le berimbau, nombre
de flûtes et instruments à anche telles le shakuhachi, le ney, le kaval, le
sheng et le mizmar, ainsi que diverses percussions. Fasteau est décédée en
2020.
Dans les années 1960, plusieurs musiciens vont réfléchir à des moyens qui
leur permettraient de mieux contrôler, hors des circuits traditionnels, la
production et la diffusion de leur musique; certains viendront à la conclusion qu’une
mise en commun de certaines ressources pourrait les aider à atteindre des buts
artistiques et communautaires d’une façon qui favoriserait la coopération
plutôt que la compétition qui marquait traditionnellement la culture
jazzistique. J’ai déjà parlé à propos de Carla Bley de la tentative de la Jazz Composer’s Guild à New York, mais d’autres
mouvements coopératifs apparaîtront ailleurs qui auront une influence durable
sur leurs communautés locales; c’est le cas par exemple de l’Underground
Musicians Association (plus tard l’Union of God’s Musicians and Artists
Ascension) en Californie, sous l’égide de Horace
Tapscott et de la pianiste et chanteuse Linda Hill, qui a tenu un rôle central au sein
du collectif, dont une autre membre importante était la flûtiste Adele
Sebastian. À Chicago, l’Association for the Advancement
of Creative Musicians, fondée en 1965, accueillera en son sein nombre de
femmes de la communauté afro-américaine de la ville au cours de ses six
décennies d’existence. Parmi les premières membres, on retrouve la pianiste,
organiste et chanteuse Amina
Claudine Myers. Ayant
accompagné Gene Ammons dans sa jeunesse, on l’entend ensuite sur disque avec le
saxophoniste Maurice McIntyre, puis à la fin des années 1970 au sein du groupe de Lester Bowie, avec lequel elle tourne en
Europe. Installée à New York en 1976, elle réalise à partir de la fin des
années 1970 bon nombre de disques pour des étiquettes comme Leo, Soul Note,
Minor Music et Novus. On la retrouve aussi au sein des groupes de Muhal Richard
Abrams, Frank Lowe, Anthony Braxton, Henry Threadgill et du Liberation Music
Orchestra de Charlie Haden. Elle a aussi composé des œuvres pour orchestre,
pour chœurs, et pour petits ensembles; en 2010, pour le Chicago Jazz Institute,
elle réalise une œuvre pour big band en l’honneur du centenaire de Mary Lou
Williams. Parmi les autres musiciennes qui firent partie de l’AACM, mentionnons
également la multi-instrumentiste Shanta Nurullah,
qui a été co-fondatrice de deux groupes de femmes au sein de l’association,
Sojourner et Samana. Depuis la fin de la décennie 2000, par ailleurs, deux
présidentes se sont succédé à la tête de l’AACM, d’abord la flûtiste et
compositrice Nicole Mitchell, puis la percussionniste et chanteuse Coco
Elysses.
Parmi les musiciennes issues de
l’avant-garde, mentionnons aussi la guitariste Monnette
Sudler, active dès les années 1970 à Philadelphie au sein du
collectif Sounds of Liberation, auprès du saxophoniste Byard Lancaster et du
vibraphoniste Khan Jamal. Sudler a aussi publié plusieurs disques sous son nom
depuis la fin des années 1970, couvrant une large palette stylistique.
Un groupe relativement oublié que j’ai
découvert un peu par hasard, le trio californien Heroines a réalisé un seul album pour Cadence Jazz Records
dans les années 1980. On y retrouve la saxophoniste Jan Labate, la bassiste
Victoria Trent et la batteuse Sybl Joan Glebow; dans les notes, cette dernière
affirme : «nous jouons en tant que femmes, voyageant selon notre
perspective propre. Notre nom honore toutes les héroïnes de la Terre – passées,
présentes et futures.» Je n’ai retrouvé des traces de Labate et Glebow que sur
un disque du Ritual Band du saxophoniste John Gruntfest. Écoutons donc ces
héroïnes dans la pièce-titre de leur album, She’s Back:
En Europe, l’influence du free jazz
sera déterminante, autant au point de vue musical qu’au point de vue politique.
Dès la fin des années 1960, la pianiste suisse Irène
Schweizer s’affirme comme une des figures majeures du free européen,
mouvement qui s’élargira bientôt à des formes d’improvisation nouvelles sous
l’impulsion de musiciens comme Derek Bailey, Peter Brötzmann, Han Bennink, et
bien sûr Schweizer elle-même. D’abord pianiste relativement conventionnelle,
dans un style hard bop, Schweizer s’intéresse vite au free jazz qu’elle entend
d’abord sur disque. Elle reçoit un choc en voyant Cecil Taylor en concert en
1966, et elle donne bientôt une nouvelle orientation à son trio, dont le
batteur est alors celui qui sera plus tard fondateur du groupe krautrock Guru
Guru, Mani Neumeier. Elle fait ensuite partie des groupes
du batteur Pierre Favre entre 1968 et 1970, qui laissent deux disques marquants, Santana
et Pierre Favre Quartett, ce dernier avec Evan Parker. Dans les années 1970, elle
co-dirige des groupes avec le saxophoniste et clarinettiste Rüdiger Carl; c’est
aussi à cette époque qu’elle commence à donner des récitals en solo (un de ses
premiers albums solo s’appelle Hexensabbat, le Sabbat des Sorcières…). À
la fin des années 1970, elle rejoint le Feminist
Improvising Group avec la chanteuse Maggie Nicols, l’ancienne membre de
Henry Cow Lindsay Cooper (bassoniste et oboïste), et la réalisatrice Sally
Potter, entre autres. Le groupe devient au début des années 1980 le European
Women’s Improvising Group, et les différentes éditions du festival Canaille
(dédiées à la musique improvisée faite par des femmes), ainsi que le trio Les
Diaboliques, fondé dans les années 1990 avec Nicols et la contrebassiste Joëlle
Léandre, s’inscrivent dans la suite du FIG.
On ne pourrait
résumer ici toutes les activités de Irène Schweizer depuis les années
1980; je me contenterai de mentionner qu’elle a été une des fondatrices du
Taktlos Festival et du label Intakt, et qu’en plus de ses fréquents récitals en
solo, elle privilégie les duos avec des percussionnistes improvisateurs au nombre desquels on peut compter, depuis la fin des
années 1980, Louis Moholo, Günter Sommer, Andrew Cyrille, Han Bennink, Joey
Baron, et bien sûr son vieux camarade Pierre Favre. J’ai trouvé en ligne ce
petit vidéo d’environ 5 minutes qui me semblait bien résumer un certain esprit,
autant politique qu’esthétique, incarné par le jeu et la carrière de Irène
Schweizer:
Issue de la musique contemporaine, la contrebassiste française Joëlle Léandre est une autre représentante incontournable de la musique improvisée européenne depuis le début des années 1980. Proche du Feminist Improvising Group (elle réalise déjà un album en trio avec Maggie Nicols et Lindsay Cooper en 1982), Léandre va aussi participer aux éditions du festival Canaille auprès de Irène Schweizer, entre autres. Utilisant la voix comme complément à son instrument, Léandre pratique une forme d’improvisation assez radicale et pas toujours facile d’approche, mais la seule étendue de sa discographie révèle l’importance et la durabilité de l’œuvre de cette musicienne inclassable. Comme Irène Schweizer, Joëlle Léandre privilégie les performances en solo, en duo ou en petites formations; parmi ses interlocuteurs on a pu compter George Lewis, Derek Bailey, Steve Lacy, Anthony Braxton, les saxophonistes Daunik Lazro et Urs Leimgruber, le violoniste Carlos Zingaro, le clarinettiste François Houle, la chanteuse Lauren Newton, et bien sûr les contrebassistes Peter Kowald, Barre Phillips ou William Parker.
Si le climat des années 1970 permet
des expérimentations de toutes sortes, il est aussi de plus en plus favorable à
la reconnaissance des femmes de jazz; pour certaines des pionnières encore
actives, le moment est propice pour revenir sur le devant de la scène. C’est
par exemple le cas de Mary Lou Williams,
qui s’était retirée dans la campagne française dans les années 1950 avant de
revenir à New York. S’étant convertie au catholicisme, elle se dédie alors à
aider les personnes en situation d’itinérance et les musiciens souffrant
d’alcoolisme ou de toxicomanie, notamment à travers sa fondation Bel Canto,
qu’elle finance en partie grâce aux profits accumulés par sa nouvelle compagnie
de disques, Mary Records. En 1957, elle apparait au festival de Newport avec
l’orchestre de Dizzy Gillespie, jouant des extraits de la Zodiac Suite.
Bientôt, préfigurant l’expérience spirituelle de
Alice Coltrane et aussi les concerts sacrés de Duke Ellington, Williams se
consacre à écrire de la musique religieuse, notamment l’hymne St. Martin de Porres (Black Christ of the Andes), puis Music for Peace (aussi
connu sous le titre de Mary Lou’s Mass). Revenue à la performance de
jazz profane, Mary Lou Williams est une des rares musiciennes de cette époque
dont les performances peuvent toucher à tous les styles de jazz, depuis le
ragtime jusqu’au free jazz, qu’elle expérimente en duo avec Cecil Taylor sur
l’album Embraced. Dans ses dernières années, elle est artiste en
résidence à la Duke University, est invitée à la Maison Blanche par le
président Carter, et apparaît régulièrement dans un club baptisé The Cookery à
New York; on la voit aussi aux festivals de Monterey et de Montreux. Je vous
propose de regarder un extrait de son passage dans un cabaret newyorkais
baptisé Les Mouches en 1978, en duo avec la bassiste Carline Ray, qui avait
fait partie des Sweethearts of Rhythm dans les années 1940; elles jouent un
extrait de Mary Lou’s Mass, une pièce intitulée Medi II:
Mary Lou Williams est décédée d’un cancer en 1981; un mois après ses funérailles, un concert en son hommage au Town Hall réunissait un bon nombre de jazzwomen, notamment Barbara Carroll, Hazel Scott, Rose Murphy, et un orchestre dirigé par Melba Liston.
Ce concert-hommage s’inscrit parmi de nombreuses initiatives qui, à partir de la fin des années 1970, vont commencer à redonner aux femmes de jazz la place qui leur est due; en 1977, par exemple, paraissent une série d’anthologies sur l’étiquette Stash, d’abord l’album double Jazz Women : A Feminist Retrospective, puis trois volumes thématiques baptisés Women in Jazz; les notes en avaient été écrites par l’historien Frank Driggs (j’ai d’ailleurs tiré plusieurs des pièces que je vous présente d’une version en CD double parue sur l’étiquette Jass en 1989 sous le titre Forty Years of Women in Jazz). En 1979, l’historienne féministe du jazz Rosetta Reitz fonde Rosetta Records, un label consacré à la réédition d’enregistrements de chanteuses et musiciennes de jazz et de blues. Au début des années 1980 paraissent les premières véritables études historiques, d’abord Black Women in American Bands & Orchestras, de D. Antoinette Handy; ensuite American Women in Jazz, de Sally Placksin; et enfin le livre que j’ai utilisé comme point de départ de mon propre panorama, Stormy Weather de Linda Dahl (Dahl a également publié des biographies de Mary Lou Williams et de la chanteuse Susannah McCorkle). En 1985 paraît aussi une première discographie consacrée aux jazzwomen par Jan Leder.
Mais ce mouvement de reconnaissance
des jazzwomen n’est pas uniquement le fait d’historiennes et historiens :
en 1978, deux journalistes, Carol Comer et Dianne Gregg, organisent le premier Women’s Jazz Festival à Kansas City. Pendant 8
ans, le festival va présenter des concerts de formations établies, mais aussi
des jam sessions, des ateliers et des conférences traitant de problématiques
spécifiques aux femmes qui ont à naviguer dans le monde du jazz. Un festival
similaire, organisé par la United Jazz Coalition et sa directrice Cobi Narita,
a lieu à New York la même année; aujourd’hui l’organisation International Women
in Jazz et son festival annuel sont des descendants directs du travail de
Narita. De même, l’édition 1981 du Kool Jazz Festival (un
avatar du festival de Newport) présente un important événement dédié aux
musiciennes de jazz, baptisé Women Blow Their Own Horns. Dans le même esprit se déroule l’année suivante à Londres un
festival entièrement dédiée aux femmes baptisé Early Evening Jazz.
Parmi
les manifestations qui marquent la période débute à la fin des années 1970, on
peut aussi compter la formation d’un groupe féminin en 1977 qu’on pourrait qualifier de All-Stars pour une apparition
au Today Show, puis pour PBS, et enfin pour un album dont le titre, Now’s
the Time, semble annoncer une nouvelle ère d’appréciation pour les femmes
de jazz; on retrouve dans ce quintette Marian McPartland (le disque est publié
sur son label, Halcyon), Mary Osborne, Vi Redd, la batteuse Dottie Dodgion et
la contrebassiste Lynn Milano. Les voici sur I'll Remember April:
Pour terminer ce large panorama, j’ai voulu mentionner certaines musiciennes apparues dans les années 1970 et 80, celles qui ont essentiellement fait le pont avec la période contemporaine, où les jazzwomen ne sont heureusement plus une exception. Citons d’abord la pianiste Connie Crothers, étudiante de Lennie Tristano et une de ses plus fidèles disciples. Le quartette qu’elle a longtemps co-dirigé avec le saxophoniste Lenny Popkin était une extension directe de la manière de Tristano; mais Crothers a aussi enregistré en duo avec Max Roach et pratiqué des formes d’improvisation libre. Elle est décédée en 2016. Celle qui tenait la plupart du temps la batterie au sein du quartette Crothers-Popkin mérite aussi une mention ici, puisqu’il s’agit de la fille même de Lennie Tristano, Carol, qui a aussi réalisé un album de batterie solo, Drum Story. Née à Baltimore, la pianiste Jessica Williams avait débuté avec la formation de Philly Joe Jones sur la Côte Est à la fin des années 1970 avant de se relocaliser en Californie. Membre du trio maison du Keystone Korner à San Francisco, elle y accompagne les musiciens de passage, par exemple Eddie Harris ou Stan Getz. Depuis les années 1970, elle a fait paraître une quarantaine d’albums (!!!) sous son nom, dont plusieurs sur son propre label, Red and Blue. Une autre pianiste californienne, Joanne Brackeen (née Joanne Grogan), avait débuté à la fin des années 1950, accompagnant sur la scène locale des musiciens comme Dexter Gordon ou Teddy Edwards. Elle épouse en 1965 le saxophoniste Charles Brackeen, avec lequel elle se rend à New York. En 1969, elle rejoint les Jazz Messengers de Art Blakey; elle reste la seule femme à avoir fait partie de ce fameux groupe. Elle jouera ensuite avec Joe Henderson, puis Stan Getz, avant de lancer sa carrière solo. Parmi les sidemen (qui sont effectivement plutôt des hommes) qui ont participé à ses albums depuis les années 1970, notons les contrebassistes Eddie Gomez, Clint Houston et Cecil McBee, les batteurs Billy Hart et Jack DeJohnette, et les saxophonistes Joe Henderson et Branford Marsalis. Brackeen est également enseignante au prestigieux Berklee College of Music. Une des élèves de ce fameux collège, justement, la guitariste Emily Remler a eu une carrière malheureusement trop courte, causant une certaine sensation dans les années 1980. Installée à la Nouvelle-Orléans, elle est remarquée par le vétéran Herb Ellis en 1978, qui la présente la même année au Concord Jazz Festival; elle obtient un contrat avec le label californien du même nom en 1981. En plus de ses six albums pour Concord (dont East to Wes, un hommage à une de ses principales influences, Wes Montgomery), elle tourne avec la chanteuse de bossa nova Astrud Gilberto et enregistre en duo avec Larry Coryell. Brièvement mariée au pianiste Monty Alexander, elle semble avoir effectué un virage vers une forme de jazz-pop avec son dernier album, This is Me, pour le label Justice. Emily Remler est décédée en 1990 d’une crise cardiaque (probablement causée par une addiction à l’héroïne) lors d’une tournée australienne. Parmi les instrumentistes importantes apparues à au début des années 1980, mentionnons aussi Jane Ira Bloom, une des rares musiciennes à se consacrer uniquement au saxophone soprano. Élève du saxophoniste George Coleman, Bloom avait fondé son propre label, Outline, à la fin des années 1970. C’est avec un disque pour l’étiquette allemande Enja, Mighty Lights, en 1982, qu’elle est d’abord remarquée; elle y était accompagnée de Charlie Haden et Ed Blackwell, en plus d’un de ses fréquents collaborateurs, le pianiste Fred Hersch. Bloom s’est intéressée au potentiel des instruments électroniques à la fin des années 1980, et a même reçu une commande d’œuvres de la part de la NASA en 1989 (et un astéroïde a été baptisé en son nom!). En 2017, Jane Ira Bloom a réalisé un album inspiré des œuvres de Emily Dickenson, paru comme ses autres albums plus récents sur son label Outline, réactivé depuis 2008. Une autre musicienne contemporaine importante, la batteuse Terri Lyne Carrington a d’abord été une élève de Jack DeJohnette. Entrée à Berklee à l’âge de 11 ans, Carrington s’illustre surtout dans le jazz fusion, par exemple avec Wayne Shorter, John Scofield ou Herbie Hancock; on l’a aussi entendue accompagner les chanteuses Dianne Reeves et Cassandra Wilson. À la fin des années 1980, elle rejoint à la télévision les orchestres maison du Arsenio Hall Show et de VIBE, produit par Quincy Jones. Si ses albums en solo la voient souvent inviter de vedettes comme Carlos Santana, Grover Washington Jr. ou George Duke, on la trouve aussi au sein de projets moins commerciaux, comme Structure, en 2004, ou un trio avec David Murray et Geri Allen, en 2016. Enseignante au Berklee College of Music depuis 2007, Terri Lyne Carrington a aussi remporté des prix Grammy pour deux de ses albums, dont The Mosaic Project en 2011, sur lequel des chanteuses venues du jazz et du R&B étaient accompagnées par une cohorte de musiciennes, dont Ingrid Jensen, Geri Allen et Anat Cohen.
Parmi les pianistes qui émergent dans les années 1980, mentionnons d’abord
Michele Rosewoman (on appréciera la féminisation
de son nom de famille, qui était originalement Roseman). Issue de la scène
d’avant-garde californienne, elle fait ses classes auprès des Julius Hemphill,
Butch Morris et Oliver Lake. Installée à New York, elle enregistre avec Billy
Bang avant de réaliser son premier album, The Source, avec le
trompettiste Baikida Carroll. Proche de la génération M’BASE, elle collabore
avec Greg Osby et Steve Coleman; les deux saxophonistes se retrouvent sur son
second album, Quintessence. Également marquée par la musique cubaine,
elle dirige parallèlement l’ensemble New Yor-Uba depuis 1983. Originaire de la région
de Detroit (comme Terry Pollard, Dorothy Ashby et Alice Coltrane!), Geri Allen avait étudié avec Kenny Barron, puis en
ethnomusicologie. Si elle a démontré des affinités avec l’avant-garde (elle a
collaboré avec Oliver Lake, Joseph Jarman et Frank Lowe par exemple), on va
surtout la retrouver au sein du mouvement M’BASE, auprès de Steve Coleman, Greg
Osby et Gary Thomas. À partir de la fin des années 1980, c’est le trio avec
Charlie Haden et Paul Motian qui va marquer son retour à un jazz plus
acoustique, mais pas moins audacieux. En 1996, elle devient une des rares
pianistes à s’intégrer dans l’univers de Ornette Coleman, avec lequel elle enregistre
les deux volets de Sound Museum. Elle joue aussi sur plusieurs albums du
trompettiste Wallace Roney, qui sera aussi longtemps son compagnon. Dans les
années 2000, elle collabore avec Charles Lloyd, le Trio 3 (avec Oliver Lake,
Reggie Workman et Andrew Cyrille) et Ravi Coltrane, en plus de réaliser
plusieurs albums, dont une relecture de la Zodiac Suite avec le Mary Lou
Williams Collective, en 2006. Geri Allen est décédée en 2017 d’un cancer, deux
semaines après son 60e anniversaire. Une autre figure majeure du
jazz contemporain, Marilyn Crispell est d’abord étudiante en piano et en composition au
New England Conservatory à Boston. Elle passe au jazz suite à l’écoute de A
Love Supreme de John Coltrane; le saxophoniste demeurera une influence
majeure, et Crispell a inclut plusieurs de ses compositions dans son
répertoire. Fréquentant le Creative Music Studio à Woodstock à la fin des
années 1970, elle y est remarquée par Cecil Taylor; elle y rencontre aussi Anthony Braxton, qui l’invite bientôt à rejoindre ses groupes,
notamment son quartette avec Mark Dresser et Gerry Hemingway, un des groupes
majeurs de l’avant-garde de cette époque. Elle commence aussi à publier ses
propres disques, dont plusieurs trios (notamment avec Reggie Workman) et un
album solo en hommage à Coltrane (For Coltrane, enregistré en 1987, paru
en 1993). Développant progressivement une sensibilité
qu’on pourrait qualifier d’européenne, elle commence à enregistrer pour
ECM, d’abord avec un album double dédié aux compositions de Annette Peacock; dans
un genre différent, elle collabore aussi avec le trio de Evan Parker, et aussi
avec différents ensembles dirigés par le contrebassiste de ce trio, Barry Guy. Crispell
demeure une des instrumentistes incontournables issues du jazz depuis plus de
40 ans.
-------
Si les big bands des années 1930 et 40
ont été de formidables pépinières de talents, on a trouvé peu d’équivalents aux
Melodears ou aux Sweethearts of Rhythm dans la période contemporaine pour les
musiciennes en herbe en dehors des big bands universitaires; on comptera comme
exception la Company de Melba Liston,
d’abord assemblée comme un septette féminin pour l’édition 1979 du Women’s Jazz
Festival de Kansas City. Ce sont les organisatrices de ce festival qui vont
persuader Liston de revenir de Jamaïque, et on peut imaginer que l’atmosphère
un peu plus favorable rendue possible par les différentes initiatives dont j’ai
parlé plus haut sont aussi en partie responsables de son retour aux USA. Quelques
années plus tard, sa compagnie s’était élargie et incluait aussi des musiciens masculins (elle avait dit, après
son expérience avec un orchestre féminin dans les années 1950, «je ne crois pas
que j’aurai jamais un groupe de filles de nouveau. Mais j’aurai des femmes dans
mes groupes, et je les adore!»). Parmi les musiciennes qui passeront par l’ensemble
de Liston dans les années 1980, mentionnons les saxophonistes Fostina Dixon et
Erica Lindsay, la corniste Sharon Freeman, la pianiste Chessie Tanksley et une
protégée de Liston, la tromboniste Janice Robinson.
À cette époque, Melba Liston affirme : «le mouvement de libération de la
femme, je n’ai rien eu à voir avec ça. Mais ça a apporté beaucoup d’attention
sur les épreuves auxquelles nous faisons face. La relation homme-femme… c’est
vraiment quelque chose!» Si Liston n’a pas fait de disque avec son ensemble à
cette époque, j’ai trouvé cet extrait filmé où son orchestre joue une
composition de Mary Lou Williams, co-écrite par le saxophoniste Shafi Hadi,
intitulée Shafi:
Souffrant d’un ACV qui la laisse partiellement paralysée, Melba Liston doit abandonner le trombone en 1985; cependant, ses talents de compositrice et d’arrangeuse restent intacts, et elle réalise dans les années 1990 certaines de ses partitions les plus brillantes pour Randy Weston, pour les albums The Spirits of Our Ancestors, Volcano Blues, Earth Birth et Khepera. Melba Liston est décédée en 1999.
-------
Voilà donc la fin de ce panorama des femmes dans le jazz; évidemment, plusieurs
historiennes et musiciennes ont aujourd’hui poursuivi les travaux initiés dans les
années 70-80 par Linda Dahl et ses consoeurs : il existe par exemple
aujourd’hui au Berklee College of Music un département baptisé Institute of
Jazz and Gender Justice, fondé par Terri Lyne Carrington. On aura compris que
le sujet des femmes dans le jazz est vaste – la
préparation de cette diffusion a été un peu un marathon pour moi… J’aurais pu
tenter d’aborder plusieurs facettes qui n’ont été qu’effleurées dans le livre
de Dahl, par exemple les positions souvent équivoques ou surprenantes des jazzwomen face à la question même
des femmes dans le jazz, ou encore les questions qui font intersection entre le
racisme et et genre, celle du harcèlement parfois vécu par les femmes qui ont
dû se tailler une place dans le showbusiness, ou encore celle de l’identité
sexuelle; une des interviewées indique par exemple qu’il y avait un
sous-entendu à propos des femmes qui faisaient partie des orchestres féminins,
à l’effet que celles-ci étaient majoritairement lesbiennes. Si j’ai préféré me
concentrer sur la musique et la présentation de musiciennes qui ont laissé une
marque dans l’histoire du jazz, c’est que ces questions ont certainement été
traitées avec toute la sensibilité nécessaire par des chercheuses
contemporaines. Si j’ai pu par ma modeste diffusion contribuer à faire
découvrir à certaines et certains d’entre vous quelques femmes exceptionnelles, même du haut de mon privilège masculin, je m’en
réjouis; j’espère ne pas avoir oublié trop de ces musiciennes formidables, qui
ont souvent surmonté des préjugés tenaces pour faire entendre leur voix au
milieu d’une sous-culture
souvent machiste et misogyne. Je tiens à saluer ici le courage de ces
pionnières, et à encourager celles qui, encore aujourd’hui, se mettent de
l’avant et tiennent à propager ce qu’il y a de meilleur dans l’esprit du
jazz : cet esprit de communauté, de résilience et de créativité qui a su
triompher des obstacles raciaux et de genre. Sur ce, je vous dis à la prochaine
sur cette pièce tirée du deuxième album de Vi Redd, Lady Soul, une pièce
qui s’appelle… That’s All!